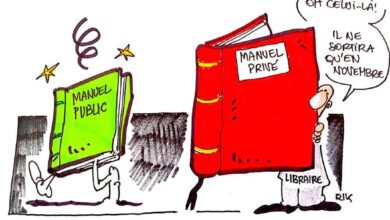Enseignement supérieur marocain : la prospective, cadre analytique des réformes

Par Dr. Brahim Akdim
Professeur à l’UPF, ex-vice-président et professeur honoraire de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès.
La prévision est essentielle pour la réussite des décisions managériales. L’utilité d’une alternative décisionnelle dépend généralement de son adéquation aux états futurs de son contexte. Ceci s’applique à tous les chantiers, y compris dans l’enseignement supérieur.
Dans ce secteur stratégique, offrir un service public de qualité est à présent, et le restera en perspective, un objectif clé de l’agenda des décideurs. Mais l’atteinte de cet objectif nécessite une profonde assimilation des enjeux, défis et caractéristiques évolutives des contextes socioéconomiques passés, présents et futurs. Le système universitaire adapté et innovant nécessite, dans le cadre de réformes, l’élaboration de stratégies pertinentes tout en prévoyant leurs moyens d’implémentation les plus adaptés.
L’objectif de cette contribution est donc de sensibiliser aux bons usages de l’approche prospective dans tous processus éventuel de réforme de l’enseignement supérieur. Ses apports sont fondamentaux pour les bons choix et orientations futures. Trois volets, considérés comme fondamentaux, seront abordés dans cet article. Ils représentent la méthode prospective et ses étapes, notamment dans l’enseignement supérieur, ainsi que le rappel de quelques enjeux prospectifs de l’université de demain.
Concernant l’approche, on peut dire qu’une planification future doit s’inspirer des caractéristiques contextuelles du présent et du passé. En effet, ma rétrospective permet de dégager les tendances et donc les éléments probablement fondateurs de l’avenir. «Le passé est la matrice de l’avenir» dans la mesure où il éclaire les effets potentiels du changement sur la fabrication des réalités de demain.
Les préalables de toute activité académique, de recherche et d’innovation, ainsi que les prérequis de toute réforme future du système universitaire, imposent donc une profonde exploration des besoins actuels ou qui vont émerger des contextes environnants dans l’avenir. C’est une condition qui s’impose avant même de concevoir les stratégies et mesures nécessaires pour les satisfaire. Cela dépend des capacités des acteurs (responsables, enseignants, futurs enseignants, étudiants, partenaires socioéconomiques, ONG, etc.).
Parmi ces capacité, leur pouvoir de développer des réflexions critiques pour des solutions créatives aux problèmes de l’avenir. Ces actions doivent cependant intégrer, au fur et à mesure, les nouvelles contraintes émergeant de la pratique. Le système de veille stratégique est essentiel dans ce processus. Il consiste à instaurer des mécanismes de surveillance permanente des mutations en cours dans les contextes aussi bien de proximité que lointains pour pouvoir décider convenablement pour le futur.
À différentes échelles, la veille gagnerait à être transversale (intégrant la collecte et l’analyse de l’information provenant de toutes les structures du système), collaborative (pour assurer la permanence des flux d’information), fluide (pour faciliter ces flux) et intelligente pour pouvoir détecter les signaux porteurs de changements.
Avec les nouvelles techniques d’information et de communication ainsi que les fonctionnalités offertes par le Web connecté et ses plateformes (l’intelligence artificielle, les bases de données et les archives ouvertes par exemple), on dispose d’outils sophistiqués de veille, qui sont des opportunités à saisir pour une planification plus adaptée de l’action.
Les bonnes orientations de la réforme prospective de l’enseignement supérieur sont conditionnées par des prérequis multiples dont une vision perspicace, des données fiables, des choix basés sur des scénarios réfléchis et, enfin, un bon système de veille. Ce dernier prérequis nous semble extrêmement important, car avant toute réforme il faut étudier les scénarios les plus plausibles pour optimiser les gains, agir sur la faisabilité et amplifier les impacts positifs de la réforme.
Sachant que l’évolution antérieure du système éducatif pèse sur le présent, et probablement sur le futur, ses grandes tendances peuvent servir dans la prospective. Cette dernière doit cependant être traitée avec précaution, dans un contexte où le changement se fait à rythmicités variables, amplifiant par conséquent la complexité de définir les besoins en ressources humaines ou solutions techniques et scientifiques aux problèmes de demain. Des incertitudes existent lorsqu’on aborde ces besoins au futur.
L’approche par scénarios possibles permet au décideur d’étudier et de choisir le meilleur à mettre en œuvre. La planification par scénarios de l’enseignement supérieur intègre donc une analyse des facteurs qui influenceront la demande et l’offre dans les prochaines décennies. Ces facteurs peuvent être démographiques, socioéconomiques, technologiques, etc. Ils vont engendrer des besoins en recherche et innovation ou en compétences et expertises.
Chaque scénario de réforme doit assimiler les contraintes du contexte et se fixer des priorités car, souvent, les moyens financiers, humains ou logistiques nécessaires pour la réalisation de toutes les actions peuvent être contraignants face à l’ampleur des besoins. Il est donc fondamental de définir les priorités. Celles-ci peuvent dépendre des moments et temporalités de la réforme.
Leur identification est fonction de la connaissance des vrais défis de la société, de l’économie et de l’environnement actuel ainsi que de leurs mutations. Mais quelle que soit la précision des mesures préconisées ou des priorités retenues, la dynamique des contextes peut induire des imprévus et donc nécessiter une certaine liberté d’adaptation des réformes aux exigences des nouveaux contextes. En prenant en considération ces postulats, on peut donc discuter de certaines configurations les plus probables des systèmes universitaires marocains du futur.
En effet, en essayant de satisfaire ses besoins propres, le Maroc interagira certainement aussi avec son contexte mondial. Il doit prendre en considération ses nouvelles contraintes et en saisir les nouvelles opportunités. Il sera appelé à adapter en permanence son système d’enseignement supérieur. La stabilité des professions affrontera davantage un vrai défi d’adaptation, car les compétences sollicitées seront aussi changeantes dans le temps.
Le rapport annuel du forum économique mondial (2023) prévoit un futur volatil des marchés de l’emploi, le déclin de nombreux métiers et des changements majeurs dans la nature des compétences qui seront sollicitées en perspective. Mais on voit déjà se dessiner l’énorme besoin d’expertise en intelligence artificielle, cybersécurité, gestion des transitions énergétiques et écologiques, design d’expériences immersives en éducation, commerce digital, divertissement et autres domaines créatifs, urbanisme intelligent et durables, éthique, biotechnologie, communication, langues étrangères, médiation et animation culturelle et sociale, santé physique et mentale, ingénierie sociale inclusive et autres métiers…
Autant de domaines qui nécessiteront des compétences techniques et humaines de créativité, d’esprit critique et d’adaptabilité permanente pour répondre aux exigences d’environnements inédits. De nombreux profils formés actuellement à l’université affronteront les défis de l’inadéquation dans un marché de l’emploi changeant rapidement. Ils seront probablement incapables d’en gérer les complexités en l’absence de fortes compétences d’adaptation, agilité et innovation.
L’enseignement supérieur doit donc cibler davantage le développement des compétences d’adaptation permanente des apprenants, leur agilité et ouverture d’esprit pour pouvoir assimiler les métamorphoses de l’environnement et créer les solutions pertinentes aux problèmes du futur en temps opportun.
Il y a lieu également d’encourager l’innovation didactique, e-learning, réalité virtuelle et apprentissages hybrides ciblant le développement des compétences tels que l’approche classes inversées et autres didactiques plus sophistiquées. Une professionnalisation croissante et synergique axée sur le développement des compétences (esprit critique, agilité, ouverture et communication), est également essentielle pour renforcer la capacité d’adaptation des apprenants.
Face aux pressions croissantes de la mondialisation et des techniques de plus en plus sophistiquées, les dimensions civilisationnelles, humaines, artistiques et culturelles du développement s’imposent. Aussi bien le capital culturel et social que l’intégration humaine et l’éthique auront leur place dans le monde de demain. Ils méritent de ce fait un accompagnement scientifique de nos futurs systèmes d’enseignement supérieur.