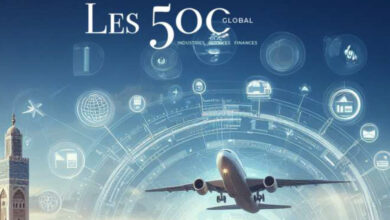Badr Bellaj : “Une monnaie numérique de banque centrale en phase R&D ou pilote n’implique pas nécessairement qu’elle voit le jour”

Badr Bellaj
Expert en blockchain
Au moment où de nombreux pays abordent des phases avancées dans leur adoption d’une CBDC, le Maroc préfère temporiser. Si la réflexion autour d’une monnaie numérique a dépassé le stade de la reflexion, la Banque centrale se dit soucieuse des implications technologiques, réglementaires et économiques d’un tel virage. Franchira-t-elle le pas?
Quel est le risque de désintermédiation des dépôts si un e-dirham est ouvert au grand public ?
Le e-dirham relèverait d’une MNBC (monnaie numérique de banque centrale) de détail, comme l’a rappelé le wali de Bank Al-Maghrib. Plusieurs modèles existent. Le premier, direct, suppose la détention d’un compte chez la Banque centrale. Le second, proche de l’existant, confie aux banques et opérateurs la gestion de la relation client.
Les risques restent comparables au système actuel, avec une différence : l’e-dirham serait isolé de la monnaie scripturale. Des plafonds de détention pourraient en limiter l’impact, tout en assurant la convertibilité. Les inconnues justifient que la phase de R&D prenne le temps nécessaire, car certaines ne se révèlent qu’au moment du déploiement. Ceci dit, si l’e-dirham est programmable, le risque de ruée bancaire s’estompe.
Le e-dirham doit-il adopter un modèle token-based ou account-based pour faciliter l’inclusion financière ?
Les deux sont envisageables. En token-based, le dirham devient une pièce numérique, équivalent du cash. En account-based, il s’inscrit dans la logique du compte, à l’image de la monnaie scripturale. Le premier est plus sécurisé et traçable, et semble mieux convenir à une MNBC. L’arbitrage final dépendra toutefois des contraintes propres à la Banque centrale.
Quelle architecture privilégier pour la distribution ?
Trois schémas existent. Le modèle direct, où la Banque centrale émet et distribue. Le modèle 2-tier (architecture à deux niveaux), où elle émet et fixe les règles, laissant aux banques et opérateurs de paiement la gestion des portefeuilles.
Enfin, le modèle 3-tier (architecture à trois niveaux), qui conserve l’infrastructure de règlement à la Banque centrale tout en confiant la distribution aux intermédiaires. Les deux derniers sont les plus crédibles, le troisième étant davantage ouvert aux fintech. Cette architecture peut répondre à des enjeux spécifiques et encourager la bancarisation des jeunes, tout en structurant un écosystème plus large.
Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO