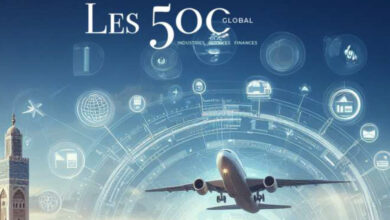Bank Al-Maghrib : la ruée vers l’or étoffe les réserves de change
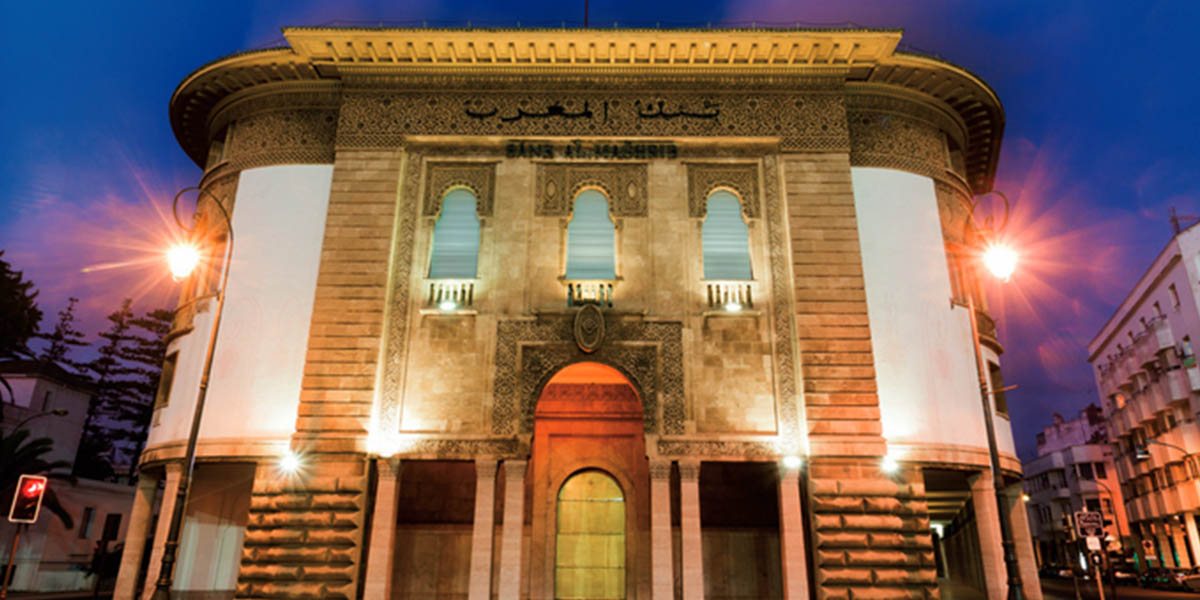
L’envolée du cours du métal jaune, qui devrait durer selon les professionnels du marché, propulse la valorisation des 22 tonnes d’or que détient Bank Al-Maghrib à des sommets et étoffe les réserves de change, estimées à 407 milliards de dirhams. La doctrine des autorités monétaires est de ne pas toucher à ce trésor de guerre en vendant une partie afin de faire rentrer du cash. La baisse du dollar et la fièvre acheteuse des banques centrales de Chine et de Russie, en plus d’incertitudes géopolitiques, alimentent cette flambée.
À 3.433 dollars l’once (ndlr : cours relevé mercredi 2 juillet en début d’après-midi), les cours du métal jaune atteignent des sommets inédits sous l’effet d’achats massifs de banques centrales (notamment la Chine, la Russie et l’Inde), des incertitudes géopolitiques et de la baisse du billet vert.
Mais chez Bank Al-Maghrib (BAM), pas question de toucher aux 22,12 tonnes du trésor de guerre. Ce stock d’or représente en effet 6% des réserves de change (41 milliards de dollars). Qu’il vente, qu’il neige ou que les cours s’envolent depuis plusieurs mois, on ne bouge pas. C’est la doctrine de BAM dans la gestion de son stock d’or, «un niveau qui n’a pas varié depuis les années soixante», selon les autorités monétaires.
Alors que le cours de l’or vole de record en record pour culminer à plus de 3.430 dollars l’once mercredi 2 juillet, pour les autorités monétaires, il n’est pas question d’acheter un peu de métal jaune pour renforcer les réserves de change, et encore moins de céder une partie des 22,12 tonnes afin de faire rentrer un peu de cash.
L’an dernier, le gouverneur de BAM justifiait la position de son institution quant à l’éventualité de profiter de l’envolée des cours du métal jaune : «Notre stock d’or représente 6% des réserves de change en valeur, soit à peu près la moyenne mondiale ; et nous sommes dans cette fourchette». Et de poursuivre : «Le problème est que l’or est une valeur refuge. Et en tant que tel, il ne vous rapporte pas de l’argent».
Au bilan de BAM, le poste «Avoirs et placements en or» abrite la contrevaleur en dirhams des avoirs en or conservés au Maroc et auprès de dépositaires étrangers, ainsi que des placements en or effectués avec des contreparties étrangères. Depuis fin 2006, ces avoirs sont valorisés au cours du marché du dernier jour ouvrable de l’année.
Avant cette échéance, ils étaient comptabilisés à la fameuse valeur historique, un des principes-clé de la comptabilité. Les plus-values ou moins-values éventuelles résultant de cette opération sont imputées au compte d’évaluation des réserves de change.
À fin 2024, la contrevaleur des avoirs en or s’est élevée à 18,78 milliards de dirhams, en hausse de 29%, sous l’effet, notamment, de la forte appréciation du cours de l’or, le stock détenu étant resté inchangé, à quelque 22 tonnes. La bonne nouvelle pour BAM est que l’appréciation du métal jaune va mécaniquement étoffer le matelas de ses avoirs extérieurs. L’once d’or pourrait atteindre 3.545 dollars l’once d’ici la fin de l’année, voire 3.900 en 2026, selon les scénarios de grandes sociétés de trading (Longforecast et WalletInvestor).
Cette fièvre sur les cours est entretenue par des «emplettes» des banques centrales de pays qui, pour des raisons géopolitiques, veulent se «dédollariser» en recomposant la structure de leurs réserves de change. Ce n’est pas le cas du Maroc dont les avoirs extérieurs reflètent la pondération de la cotation du dirham, 60% en euro et 40% en dollar. Pour le wali de BAM, ce sont les pays qui détiennent historiquement d’importantes réserves d’or qui animent le marché de l’or.
Avec près de 42 milliards de dollars de réserves de change, la priorité est d’assurer à tout moment, la couverture des besoins du pays, notamment le règlement des importations et le service de la dette extérieure. C’est le rôle de réserves de précautions constituées d’actifs disponibles et liquides permettant de satisfaire les besoins à court terme de la Banque centrale.
Abashi Shamamba / Les Inspirations ÉCO