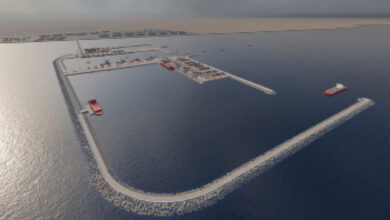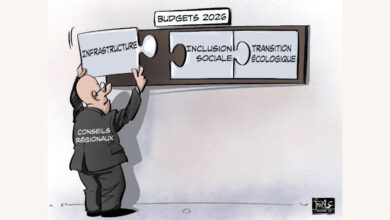Condition féminine : entre progrès visibles et écarts persistants

L’édition 2024 du rapport du Haut-commissariat au plan dresse un portrait contrasté de la femme marocaine. Les indicateurs s’améliorent en matière d’éducation, de santé et de mariage précoce, mais les inégalités économiques et sociales résistent, en particulier dans le monde rural.
L’évolution est indéniable, mais la route reste longue. En vingt ans, la femme marocaine a gagné en espérance de vie, en alphabétisation et en présence dans les études supérieures. Pourtant, ces avancées ne se traduisent pas encore pleinement sur le marché du travail ni dans la sphère économique.
Le rapport «La femme marocaine en chiffres 2024», publié par le Haut-Commissariat au Plan, révèle un double visage : celui d’un progrès social continu et celui d’un plafond d’inégalités encore bien solide.
Des indicateurs démographiques en nette amélioration
Le recul du mariage précoce figure parmi les évolutions majeures. En 2024, seules 8,4% des Marocaines âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans, contre 15,9% en 2004. L’âge moyen au premier mariage reste stable à 25,7 ans, un palier qui traduit autant la modernisation des comportements que la persistance de normes traditionnelles.
L’espérance de vie féminine atteint désormais 78,8 ans, soit 3,5 ans de plus que celle des hommes. Ce gain reflète les progrès du système de santé, notamment la chute spectaculaire du taux de mortalité maternelle, passé de 227 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2003 à 72 en 2018.
Autre transformation notable, la féminisation de la structure familiale. Près de 19,2% des ménages marocains sont aujourd’hui dirigés par des femmes, contre 16,2% en 2004. Une évolution portée par la montée du veuvage (90% des veufs âgés de 60 ans et plus sont des femmes) et par une plus grande autonomie résidentielle.
L’Éducation, un levier de changement encore inachevé
Sur le front éducatif, les progrès sont incontestables. Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus a bondi à 67,3%, contre 41,3% vingt ans plus tôt. Les Marocaines représentent désormais 61,2% des effectifs de l’enseignement supérieur, avec une domination dans les filières paramédicales où elles atteignent 75,7%. Mais cette réussite académique masque des fractures persistantes.
Près d’une femme sur deux âgée de 25 ans et plus (48,9%) n’a encore aucun niveau d’études, contre 24% chez les hommes. Et si la scolarisation des jeunes filles est quasi généralisée en primaire, les écarts réapparaissent à l’université ou dans les zones rurales.
«Les avancées enregistrées en matière d’éducation et de santé n’ont pas encore produit leurs pleins effets sur la participation économique des femmes, qui demeure faible malgré la progression de leur capital humain», souligne le HCP dans son rapport 2024.
Une intégration économique qui stagne
C’est sans doute le constat le plus préoccupant, la participation féminine au marché du travail reste figée. Seules 22% des actives occupent un emploi ou en recherchent, un taux qui n’a presque pas évolué depuis 2013. En milieu rural, la part tombe à 20,6%. Le décalage entre l’accès massif à l’éducation et la faible insertion professionnelle met en lumière un problème structurel.
La segmentation du marché de l’emploi, le poids du travail informel et la faible présence des femmes dans les postes de décision en sont les principales causes. Ces inégalités économiques ont un coût social et macroéconomique. En restreignant la moitié du capital humain national à un rôle secondaire, le pays se prive d’un levier de croissance inclusif.
Le rural reste le grand angle mort
Les écarts territoriaux demeurent frappants et continuent d’alimenter un fossé entre deux Maroc. Dans les campagnes, la mortalité maternelle reste près de deux fois plus élevée qu’en milieu urbain, avec 148 décès pour 100.000 naissances vivantes. À peine 55% des accouchements y sont assistés par du personnel qualifié, contre plus de 90% dans les villes.
Le même constat vaut pour l’éducation. Le taux d’alphabétisation féminin plafonne à 57%, quand il atteint 83% en milieu urbain. Ces différences ne se limitent pas aux infrastructures scolaires ou sanitaires : elles traduisent aussi des écarts d’accès à l’information, à la mobilité et aux opportunités économiques.
Dans de nombreuses régions rurales, les femmes restent cantonnées à des activités informelles, agricoles ou domestiques, souvent sans protection sociale ni reconnaissance économique.
Faiza Rhoul / Les Inspirations ÉCO