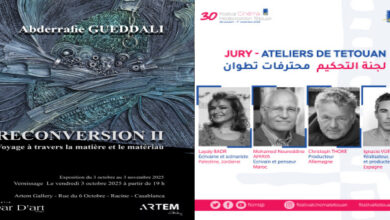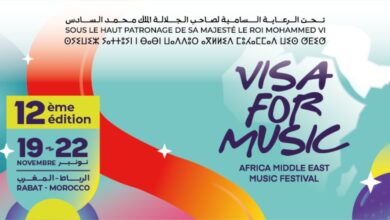Livre : comment les pilleurs font fuir les capitaux d’Afrique

Les éditions En Toutes Lettres publient «La Fuite des capitaux d’Afrique, les pilleurs et les facilitateurs». Facile à lire, ce très sérieux ouvrage d’analyse et d’investigation porte sur un problème mondial, en prenant les exemples de l’Afrique du Sud, de la Côte d’Ivoire et de l’Angola.
Léonce Ndikumana et James K. Boyce, qui ont dirigé l’ouvrage collectif, ne sont pas des inconnus. Le duo a déjà écrit «La Dette odieuse», en 2011, montrant qu’alors que le continent africain a la réputation de vivre des aides internationales, il est en réalité créancier du reste du monde.
Le système d’endettement permettant de la maintenir dans la position qu’on lui connaît. «La Fuite des capitaux d’Afrique» a été co-écrit avec les universitaires Adam Aboobaker (Royaume-Uni), Melvin D. Ayogu (États-Unis), Jean Merckaert (France), Karmen Naidoo (États-Unis), Léonce Ndikumana (États-Unis) et l’écrivain et journaliste Nicholas Shaxson (Allemagne). Boyce est directeur de recherche à l’Université du Massachusetts, aux États-Unis, tandis que Ndikumana est professeur dans cette même institution.
L’ouvrage se lit comme un roman étayé de chiffres solides. Paru originellement en anglais, en 2022, sa traduction francophone est publiée par trois éditeurs africains : Amalion au Sénégal, Graines de Pensées au Togo et En Toutes Lettres au Maroc. Une idéale coopération Sud-Sud, francophone, mise en place grâce à l’Alliance internationale de l’édition indépendante, un collectif professionnel qui réunit plus de 980 maisons d’édition dans 60 pays.
Les pilleurs aux mains pleines
Les auteurs notent que ce premier quart de siècle a marqué, pour l’Afrique, une envolée de sa croissance jusqu’à la crise de 2008, puis un rythme annuel de tout de même 4%. Au point que le cabinet McKinsey parlait des «Lions en mouvements», à propos des économies du continent.
Beaucoup de pays «ont fait des avancées considérables en termes de développement humain, faisant progresser l’alphabétisation et baisser la mortalité infantile», écrivent Ndikumana et Boyce en introduction. Bons connaisseurs de leur sujet, ils ne feront pas dans le misérabilisme.
Cependant, ils estiment que la fuite illicite des capitaux hors d’Afrique depuis 1970 s’élève à 2.000 milliards de dollars, dont 600 ont quitté le continent après 2000. Avec les intérêts, la «richesse privée détenue à l’étranger s’élevait à 2.400 milliards» en 2018, «soit le triple de l’encours de la dette due par ces mêmes pays, faisant de l’Afrique un “créditeur net” du reste du monde».
Quand le capital fuit l’investissement
Que les capitaux fuient le continent au moment de sa renaissance «défie la logique et la théorie économique». Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène. D’abord, il y a le cas où l’acquisition de la richesse a été illégale, et où le capital doit être «blanchi» ou soustrait aux autorités du pays. Il peut aussi s’agir d’évasion fiscale, pour une richesse acquise légalement.
Enfin, certains veulent échapper aux risques de saisie ou de nationalisation dans des pays instables politiquement. Ou simplement mal administrés.
«La crise de l’Afrique est due à un défaut de leadership et de gestion. L’Afrique subsaharienne est riche en ressources, en talent, en énergie et en esprit», déplore ainsi Ellen Sirleaf Johnson, l’ancienne présidente du Libéria. Toutefois, montre l’ouvrage, la fuite des capitaux est aussi un phénomène mondial «tiré» et facilité par des institutions et des acteurs de l’ordre économique international.
Études de cas
Au fil des chapitres, le lecteur découvre comment, en marge de l’affaire Elf Aquitaine, les hommes d’affaires Pierre Falcone et Arcadi Gaydamak avaient réussi à détourner une partie du remboursement de la dette de l’Angola à la Russie, via des comptes ouverts sur l’Île de Man et à Chypre. Les montants se chiffrent en centaines de millions de dollars.
En Côte d’Ivoire, Youssouf Carius, directeur d’un fonds d’investissement, estime qu’une «fève de cacao qui est vendue physiquement à partir du port d’Abidjan peut représenter une bonne soixantaine de transactions sur les marchés internationaux». Cette financiarisation répond à la nécessité de se couvrir contre les risques, mais a fait apparaître sur le marché du cacao de nouveaux acteurs, purement financiers, responsables d’«environ 30% des transactions». La spéculation sur le cacao a été multipliée par 4 entre 1986 et 2005.
Dans une telle situation, marchés parallèles, contrebande et malversations ont pullulé, pointent de nombreux rapports. L’histoire tourmentée de l’Afrique du Sud se reflète dans celle de son contrôle des changes. Boycottée pendant les années 1980, elle exerçait un strict contrôle de ses devises pour tenter de limiter l’hémorragie.
La libéralisation déployée pendant les années 1990, après la fin de l’Apartheid, a permis une très nette augmentation des investissements directs étrangers durant la décennie 2000. Mais la tendance semble s’inverser depuis 2010, tandis que la fausse facturation commerciale est un important canal de fuite des capitaux.
L’échec des grandes théories
En conclusion, les auteurs remarquent que les théories économiques sont de très peu d’aide pour comprendre le phénomène. «Tandis que l’école d’économie néoclassique exclut le pillage par hypothèse, l’économie marxienne le relègue souvent de manière prématurée dans les oubliettes de l’histoire», notent-ils, impartiaux.
Pour eux, le terme de «rente» devrait inclure les paiements versés à ceux qui contrôlent les marchés, les ressources et l’État. Elle est extraite à différents points de la chaîne de production du cacao en Côte d’Ivoire. Les détournements effectués dans le secteur de l’électricité par les Gupta, en Afrique du Sud, ainsi que les rentes pétrolières en Angola sont emblématiques des problèmes internes au continent. Ils enrichissent un petit groupe de plus en plus bunkérisé, au détriment de la population générale.
Il faudrait donc un meilleur équilibre entre le marché et l’État, chacun ne pouvant vivre sans l’autre. Et si «la droite favorise le marché et la gauche, l’État», le problème fondamental, pour Léonce Ndikumana et James K. Boyce, reste celui de la répartition des richesses et du pouvoir. Or, il existe «une tragique déconnexion entre les principes théoriques et la réalité économique», regrettent les auteurs. En Afrique comme ailleurs, il reste beaucoup de travail à faire.
Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO