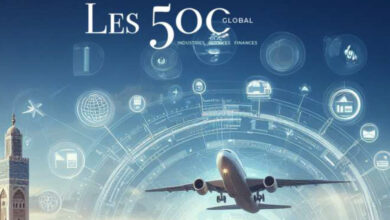Noor-Ourzazate : D’un projet à «risque» à un «modèle»
Le développement du Programme solaire marocain a nécessité l’implication de sept bailleurs de fonds internationaux. Zoom sur l’expérience de la Banque mondiale.
12%, c’est l’investissement de la Banque mondiale dans le financement du programme solaire marocain, Noor-Ouarzazate. Ceci représente 90% des investissements de la banque dans l’énergie solaire dans la région MENA. Cette participation s’est faite sous forme de prêt accordé à l’Agence marocaine de l’énergie solaire (MASEN), sous garantie étatique, de 760 MDH et un deuxième prêt de 1,62 MMDH dans le cadre du Fonds d’investissement climatique (FIC). L’institution de Washington arrive loin derrière le principal bailleur de fonds du projet, la coopération allemande, KFW avec 36% des 21 MMDH nécessaire pour les trois phases de la station Noor. L’Allemagne est suivie de la Banque africaine de développement (17%), la société Acwa Power Ouarzazate (14%) et la BM en quatrième position.
Elle est suivie de la Banque européenne d’investissement (10%), l’Agence française de développement (6%) et l’Union européenne (5%). Cet engagement financier réduit correspond à l’évaluation initialement faite par la BM. Dans un document d’évaluation daté d’octobre 2011, l’institution ne cachait pas ses craintes face à la viabilité financière de Noor-Ouarzazate. Pour la BM, le «projet ne répondait pas aux critères régionaux de financement». Les experts de la banque expliquent leur choix : «Ce projet très ambitieux comporte des risques potentiellement élevés» et «il est structuré d’une manière inhabituelle pour atténuer ces risques. Ces risques découlent de la mise en place d’une technologie coûteuse avec le potentiel de devenir une source d’énergie non-carbone concurrentielle d’une importance mondiale».
Malgré ces réticences, la BM est convaincue par le montage financier et le mode opératoire du projet (Partenariat public-privé (PPP). D’ailleurs, MASEN s’est engagée «à apporter un soutien adéquat d’atténuation des risques aux développeurs du projet» d’utiliser la technologie. La présence de l’institution internationale dans le soutien de ce projet avait pour but de trouver un modèle à dupliquer dans le reste de la région. «Noor est typiquement un projet de démonstration stratégique visant à stimuler sa duplication», ainsi qu’un outil de visibilité d’un nouveau de financement des «projets verts», comme le FIC. «Le projet permet la promotion du Fonds pour les technologies propres», rappelle la banque.
C’est dans ce sens que s’est inscrite la visite d’une équipe de la banque au Maroc et l’organisation d’un atelier en présence des représentants des gouvernements de la région MENA, le 5 mai. Experts et représentants gouvernementaux se sont penchés sur l’expérience marocaine en matière d’énergie solaire thermique à concentration. L’occasion de faire la promotion de cette technologie et des mécanismes de financement de ce type de projets. Noor-Ouarzazate sera également en vedette à la COP22, en novembre 2016.
Moëz Cherif
Economiste senior à la Banque mondiale, spécialiste des énergies et industries attractives
«Le critère du financement est la compétitivité»
Les inspirations ÉCO : Comment votre institution a accompagné le projet Noor-Ouarzazate ?
Moëz Cherif : La Banque mondiale a été impliquée depuis la conception du projet à son développement. Nous avons participé également au financement et la mobilisation de fonds à travers le FIC, avec la BAD. Nous participons aux trois phases du projet et nous continuons à travailler avec MASEN sur la suite de ce projet.
Quelles sont les spécificités du financement accordé à ce projet ?
Le financement du Fonds pour les énergies propres est à un taux concessionnel. Le deuxième financement provient de la Banque européenne pour reconstruction et le développement (BIRD), il demeure moins cher que le financement classique. C’est l’équivalent d’un financement souverain qu’on accorde au gouvernement.
Ces prêts concessionnels s’accompagnent-ils par des conditions particulières ?
Notre institution n’oriente pas les choix des pays, ce n’est pas le mode de fonctionnement de la Banque mondiale. Notre approche est d’abord rationnelle qui suppose que le pays dispose pour ce projet d’un plan d’investissement à long terme. Le critère demeure la compétitivité du projet et le recours au marché. Nous avons une préférence pour ce type de projet mais sans une préférence aveugle. Nous finançons également les projets énergétiques à base de gaz car ils ont leur place dans le mix énergétique du pays. Quand on le peut, on aime bien soutenir les énergies renouvelables.
Le projet Noor s’est inscrit comme objectif d’intégration industriel de 35% pour les phases II et III. Est-ce réalisable ?
C’était un objectif raisonnable. Les fabricants et les industriels au Maroc étaient capables de relever ce défi pour la phase I. L’industrie locale a pu fournir cet objectif, ce qui n’était pas une surprise. L’important est de ne rendre pas l’intégration industrielle obligatoire. Nous recommandons d’aller vers les fournisseurs les plus compétitifs et les mieux offrants. D’ailleurs, le développeur du projet a tout intêret d’aller vers une offre locale si elle se trouve à sa proximité et à de meilleurs prix. C’est aussi un signe d’implication dans l’économie du pays et cela consolide les liens avec les autorités du pays.