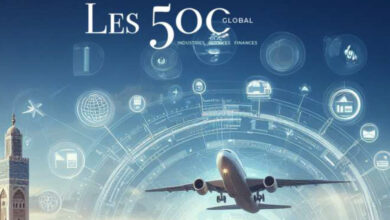Deeptech 2025 : rapprocher l’innovation du tissu productif

À l’UM6P, l’innovation n’a pas vocation à séduire, mais à servir. La deuxième édition du DeepTech Summit l’a rappelé, avec une intelligence artificielle appelée à s’ancrer dans les usages, portée par des synergies opérationnelles.
La formule peut paraître brutale, mais elle résume un mal bien connu des écosystèmes technologiques africains. Des prototypes prometteurs, des hackathons à foison, mais peu de débouchés concrets, et plus rarement des modèles qui débouchent sur des activités économiques durables. L’Université Mohammed VI Polytechnique revendique une autre approche. Elle parie sur des technologies conçues pour répondre aux besoins de secteurs clés tels que l’agriculture, la santé ou l’énergie.
Cette réalité est valable notamment pour les technologies cognitives qui n’y sont pas perçues comme une fin en soi, mais comme un levier à manier avec prudence. Pour Jalal Charaf, Chief Digital and AI Officer de l’université, l’intelligence artificielle ne peut pas être importée comme un simple module technologique sans considération des réalités locales.
«Le risque avec des modèles importés, c’est qu’ils reflètent des réalités, des biais et des objectifs qui ne sont pas les nôtres . Une technologie, aussi puissante soit-elle, reste aveugle à ce qu’elle ne comprend pas», explique-t-il.
Elle reproduit des angles morts, ignore les spécificités des territoires, impose des logiques d’optimisation souvent inadaptées aux urgences locales. Construire une autonomie passe donc par une infrastructure souveraine, une puissance de calcul maîtrisée, et surtout par un effort de recontextualisation des modèles via un entraînement fin sur des corpus locaux.
« Ce travail de réappropriation, parfois invisible, est essentiel pour que les modèles soient au service des priorités locales, et non l’inverse», résumé le Chief Digital and AI Officer de l’UM6P.
Encore faut-il disposer du temps nécessaire pour faire mûrir l’innovation. La DeepTech, par nature, exige de la patience. Elle repose sur des cycles longs, des retours différés, des investisseurs capables de soutenir l’incertain. L’université tente de combler ce vide en structurant des parcours d’incubation allant jusqu’au prototypage industriel. L’ambition est claire. Transformer un écosystème souvent cantonné au stade de «proof of concept» en un tissu capable de générer des produits, des services et une activité économique pérenne. Cela suppose aussi une nouvelle exigence dans les partenariats. Trop souvent, ces derniers se limitent aux effets d’annonce.
«On ne veut pas de simples démonstrateurs, mais des transferts de compétence, des brevets déposés ici, des startups qui émergent d’un travail commun», souligne Jalal Charaf.
Les accords qui n’apportent rien à l’écosystème sont écartés. Cette rigueur assumée soulève au passage la question des débouchés. Même avec des talents, des prototypes et un accompagnement structuré, que faire si le marché ne suit pas ? «Le problème n’est pas l’amont mais l’aval», admet Charaf.
Sans infrastructures industrielles, sans commande publique, sans prise de risque de la part des grandes entreprises, les projets restent lettre morte. Il faudrait, dit-il, une confiance active, une volonté d’intégrer les solutions locales dans les appels d’offres et de leur donner une place dans les marchés publics. En cela, la deuxième édition du DeepTech Summit a tenté de répondre à cet enjeu. Soixante-six sessions thématiques, des formats immersifs comme «Pitch in the Dark» ou «Real Talk Labs», et cette volonté constante de confronter les promesses de la technologie aux conditions concrètes de leur déploiement.
Parmi les partenariats annoncés, une collaboration avec Attijariwafa bank doit permettre aux startups de tester leurs solutions sur des cas d’usage réels liés aux métiers de la finance. Une antenne de H&S sera installée sur le campus afin de soutenir la recherche appliquée, l’entrepreneuriat et le développement de produits adaptés aux marchés africains ou encore une alliance engagée avec Africorp qui vise des projets communs dans l’agriculture, l’industrie, les mines ou encore la formation technique.
Au-delà des effets d’annonce, le DeepTech Summit 2025 a cherché à rapprocher l’innovation des structures productives. Un pas de côté, loin des récits d’accélération, tente de retisser le lien entre l’innovation et le besoin réel.
Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO