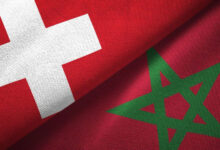Plantes médicinales et aromatiques : le congrès de Fès pose les jalons d’une stratégie nationale

La première édition du Congrès international des plantes médicinales et aromatiques s’est achevée par l’élaboration d’un rapport de recommandations structurant pour l’avenir du secteur. Experts et chercheurs de plusieurs pays ont défini une feuille de route axée sur la valorisation, la recherche et la coopération internationale.
Les travaux de la première édition du Congrès international des plantes médicinales et aromatiques (PMA), qui se sont tenus cette semaine à Fès, se sont conclus par la présentation d’un rapport de recommandations qui constituera une base pour l’élaboration d’une feuille de route stratégique destinée à la structuration de l’ensemble du secteur.
Les orientations clés émanent de deux jours d’échanges intenses sous forme d’ateliers et de conférences plénières entre experts, chercheurs et représentants de coopératives marocaines et étrangères venant, notamment, de Libye, Belgique, France, Italie, Tunisie et Égypte.
Les discussions et les échanges ont porté sur les avancées scientifiques, les applications industrielles, les cadres réglementaires et les stratégies de valorisation des PMA, dans la perspective de bâtir ce plan d’action.
Des recommandations stratégiques pour valoriser le secteur
Issu des travaux intensifs menés lors des conférences plénières, le Rapport de recommandations propose un plan d’action ambitieux pour l’avenir du secteur. Ce document stratégique s’organise autour de cinq piliers fondamentaux, à savoir la valorisation industrielle, l’innovation en recherche et développement, l’adaptation du cadre réglementaire, le renforcement des collaborations internationales et l’accompagnement des différents acteurs de la filière.
Dans le domaine de la valorisation industrielle, les experts préconisent l’adoption de systèmes de traçabilité renforcés et l’implémentation de protocoles rigoureux d’identification chimique et biologique des composants botaniques.
Le rapport met particulièrement l’accent sur l’adoption de technologies d’extraction respectueuses de l’environnement, à l’image de l’extraction par CO₂ supercritique. Les recommandations soulignent également l’importance de soutenir les processus de transformation écologiquement responsables, d’établir des chaînes de valeur intégrées depuis la matière première jusqu’aux produits élaborés (poudres, extraits, composants standardisés) et de concentrer les efforts de R&D sur la valorisation des espèces végétales endémiques du Maroc.
Recherche et innovation : catalyseurs d’un secteur en transformation
Dans le volet recherche et développement, le rapport propose une feuille de route ambitieuse pour dynamiser l’innovation. Il recommande aux chercheurs marocains de s’engager dans les programmes de financement européens tels qu’Horizon Europe et PRIMA, ainsi que dans les initiatives de l’UM6P, en simplifiant les procédures administratives et en renforçant l’accompagnement technique. La préservation des savoirs ancestraux – à travers l’ethnobotanique – constitue une priorité, tout comme l’intégration systématique de la phyto-vigilance dans les protocoles de recherche.
Le document met également l’accent sur le développement de solutions thérapeutiques innovantes, notamment des antifongiques d’origine végétale. Il préconise d’intensifier les études cliniques évaluant l’efficacité des compléments alimentaires à base de plantes, particulièrement ceux ciblant les troubles neurologiques et psychiatriques. Les projets de coopération internationale, à l’image du PHC Maghreb, sont identifiés comme des leviers stratégiques à valoriser.
Le déploiement de technologies de pointe comme l’extraction en cascade, la chromatographie HPLC, l’extraction en phase solide (SPE), la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la conception de systèmes d’administration phytopharmaceutiques constitue un axe prioritaire d’innovation. Dans le domaine réglementaire, les experts recommandent un renforcement substantiel des mécanismes de normalisation et de certification pour les produits dérivés des PMA, garantissant ainsi leur innocuité et leur efficacité thérapeutique.
L’application rigoureuse des directives ministérielles en matière de sécurité sanitaire, l’implémentation de systèmes de traçabilité complète et la prévention des intoxications liées aux usages inappropriés des plantes médicinales figurent au premier plan des préoccupations.
Synergies régionales : vers un écosystème arabo-africain intégré
Le rapport accorde une place prépondérante au développement des réseaux collaboratifs, en préconisant la formation de consortiums de recherche à l’échelle arabo-africaine et le renforcement de l’innovation transfrontalière.
Cette démarche s’appuie sur des organisations établies comme NAPRECA et la Fédération des Conseils arabes de la recherche scientifique (FCARS), permettant une mutualisation efficiente des ressources et des expertises à travers la région.
Le soutien aux entreprises et aux coopératives constitue un autre axe fondamental des recommandations. Celles-ci prévoient le déploiement de programmes de formation continue adaptés aux besoins du secteur (standards de qualité, processus de certification, stratégies de marketing digital), la structuration de réseaux d’affaires B2B et l’identification précise des obstacles rencontrés par ces acteurs économiques.
Parmi ces défis figure la concentration excessive des matières premières, l’insuffisance de coordination entre parties prenantes, les difficultés d’accès aux marchés et les barrières à la certification. Le rapport suggère également des mesures concrètes comme le développement des marchés solidaires, la protection juridique des labels, le soutien aux initiatives agricoles, notamment les pépinières spécialisées, et l’intégration de la filière PMA dans les circuits de tourisme rural. Les experts insistent particulièrement sur l’importance de la confiance des consommateurs, fondée sur des garanties tangibles de qualité et des preuves scientifiques d’efficacité pharmacologique.
Une vision holistique pour l’avenir du secteur
Au terme de cette rencontre internationale, Dalila Bousta, directrice de l’ANPAM, a mis en lumière la dimension multidisciplinaire des travaux consacrés à la transformation des plantes médicinales et aromatiques. Elle a souligné que les diverses sessions, tant les ateliers spécialisés que les conférences plénières, ont permis d’établir un diagnostic approfondi et de réaliser une analyse comparative internationale des applications industrielles dans le domaine des PMA.
Autant d’acquis qui constituent les fondements solides de la future feuille de route sectorielle. La directrice a particulièrement insisté sur l’approche participative ayant présidé à l’élaboration des recommandations stratégiques.
Cette méthodologie inclusive a été considérablement enrichie par l’implication active des coopératives provenant des régions Fès-Meknès et Souss-Massa, notamment des acteurs de la province de Tata.
Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO