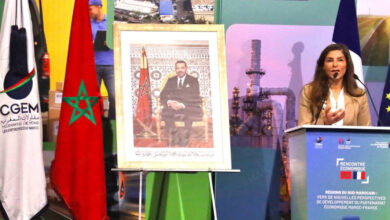Migration. Le Maroc est-il toujours une terre d’accueil ?

Il y a cinq ans, le Maroc lançait une ambitieuse Stratégie nationale d’immigration et d’asile. Aujourd’hui, des organisations de la société civile s’inquiètent des reculs en matière d’accès aux droits des migrants.
«Le Maroc a-t-il toujours la volonté d’accueillir les migrants sur son territoire ?». C’est par cette interrogation provocante qu’Aissatou Barry, membre de la société civile à Tanger et présidence de l’Association Ponts solidaires démarre son intervention lors des 4e Assises marocaines des organisations de la société civile actives en soutien aux personnes migrantes, tenues le 13 juin à Rabat. Cette défenseure des droits des migrants avait subi des pressions et arrestations de la part des autorités lors des opérations de déplacements forcés entre août et décembre 2018. Entre 4.000 et 5.000 personnes en migration ont été déplacés par les autorités dans le cadre des éloignements forcés des frontières nord vers des villes du centre et du sud du pays. Ces opérations ont marqué les esprits et planent sur le bilan annuel que présente la société civile active auprès des migrants. Après avoir présenté le 15 avril dernier le bilan gouvernemental de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA), Les Inspirations ÉCO donne la parole aux associations de la civile pour présenter leur propre bilan de cette politique publique adressée aux personnes étrangères installées au Maroc. Globalement, les acteurs de la société civile présents s’accordent à dire que l’accès aux droits à la santé, à l’éducation et à la formation connait «une stagnation». La SNIA est à appeler à se renouveler.
Blocage à la santé
«En préparant notre nouveau rapport, nous nous sommes rendus compte que nos recommandations de 2017 demeurent toujours valables en 2019», souligne Erika Ramanzini, chargée de projet du Comité européen pour la formation et l’agriculture (CEFA), organisation italienne présente au Maroc et membre des Assises. L’accès à la santé connait un blocage, selon les organisateurs. «C’est la grande défaillance détectée en 2017 puis en 2018», rappelle Ramanzini.
Malgré la convention signée entre le département des Affaires de la migration et l’Agence nationale d’assurance maladie (ANAM) en 2016 pour donner accès aux migrants au RAMED, cette décision n’a pas été activée. Selon nos informations, l’ANAM est en train de préparer un système dédié aux migrants régularisés. «Faute de cartes d’accès, les migrants souffrent de ce blocage. Les soins primaires demeurent accessibles, mais les soins secondaires et tertiaires sont payants. Même les hôpitaux faisaient des exceptions, aujourd’hui, ils ne le font plus», regrette-t-elle. Dans le domaine de l’éducation, 5.500 enfants de migrants sont scolarisés dans le système d’éducation publique. Cette étape cruciale de l’intégration se déroule dans l’ensemble dans de bonnes conditions. «Il y a une facilité d’accès au système éducatif. Mais des obstacles pour l’inscription demeurent, surtout selon les régions», poursuit Ramanzini. L’intégration au sein de l’école publique pose des difficultés de l’apprentissage de langue arabe pour les enfants déjà scolarisés dans leurs pays d’origines et surtout l’apprentissage de cours d’éducation islamique pour non musulmans. À Rabat, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et l’Académie régionale d’éducation et de formation ont signé une convention pour dispenser les enfants concernés de cette matière.
«Il faut uniformiser les démarches suivis à Rabat et Casablanca sur tout le territoire», propose Ramanzini. Enfin, les programmes de formations professionnelles proposées aux migrants commencent à afficher leurs faiblesses. «Les migrants poursuivent plusieurs formations qui se répètent dans leurs contenus, et sans trouver de réel débouchés sur le marché de l’emploi», affirme Helene Yamta, présidente de l’association Voix des femmes migrantes au Maroc.
Pour cette raison, Ramanzini insiste pour une évaluation de ces programmes et repenser le lien entre les formations et les débouchés professionnelles. La Plateforme nationale protection migrants (PNPM) qui organise chaque année les assises s’attèle à faire un nouveau diagnostic de la situation des migrants irréguliers et réguliers sur d’autres thématiques. «L’année 2018 a été marquée par les opérations de l’été dernier. Nous avons donc décidé de travailler sur l’assistance humanitaire. Nous avons travaillé également sur la situation du droit d’asile et de la protection juridique», est-il indiqué. Un bilan complet devrait être rendu public prochainement.
Hassane Ammari
Alarm Phone
Les opérations de l’an dernier et la situation dans les zones nord du Maroc devront nous amener à poser cette question. Nous avons constaté jusqu’à 4.000 refoulements dans des conditions violentes du nord vers le sud du pays, avec l’enregistrement de deux cas de décès. Les migrants font l’objet d’une traque dans les régions de Nador et Tanger.
Helena Yamt
Voix des femmes migrantes
Je me pose aussi cette question avec insistance. Du côté de la société, les violences à l’encontre des migrants se multiplient notamment à Casablanca. De l’autre côté, les autorités compliquent le renouvellement des cartes de séjour des migrants. Je crois que nous avons besoin d’une nouvelle opération de régularisation car beaucoup de jeunes veulent travailler dignement au Maroc.