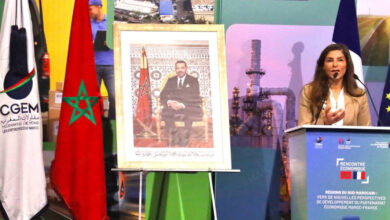Agriculture : le grand calcul de l’eau virtuelle

Le débat sur «l’exportation de l’eau», via des cultures gourmandes comme la tomate ou l’avocat, interroge le modèle agricole marocain. Face à la polémique, l’exécutif défend sa stratégie en s’appuyant sur le calcul de l’eau virtuelle, un arbitrage complexe entre impératifs économiques et gestion d’une ressource rare.
La gestion des ressources hydriques au Maroc, dans un contexte de raréfaction, a remis au premier plan les orientations stratégiques du secteur agricole. Cette situation alimente un débat public sur la pertinence de certaines filières, mettant en cause «l’exportation de l’eau» via des cultures à forte consommation hydrique, telles que la tomate ou l’avocat.
La récente sortie médiatique du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a recentré la discussion autour du concept d’eau virtuelle, présentant un calcul qui encadre la politique actuelle. L’approche gouvernementale défend la rationalité économique des exportations en s’appuyant sur un bilan hydrique global. L’analyse de cet argumentaire, si elle constitue le socle de la position officielle, s’inscrit toutefois dans une équation plus vaste, intégrant des variables climatiques, géopolitiques et sociales.
La balance commerciale de l’eau comme principe directeur
La justification de la politique agricole actuelle repose sur un bilan comparatif des flux d’eau virtuelle. Selon les données dévoilées par le chef du gouvernement, les productions agricoles destinées à l’exportation mobilisent un volume estimé à 500 millions de mètres cubes d’eau, ce qui équivaut à la capacité d’un barrage moyen.
En contrepartie, les importations, principalement céréalières, représentent l’équivalent de deux milliards de mètres cubes. Le solde de cette balance commerciale hydrique apparaît donc favorable au pays. Cet argument est renforcé par un calcul de rentabilité économique. La valeur ajoutée des fruits et légumes exportés génère des revenus en devises plus importants que les dépenses engagées pour l’importation de produits comme le blé.
Dans cette optique, les cultures exportatrices ne sont pas identifiées comme la source principale des tensions sur la ressource en eau. Le diagnostic dressé par Akhannouch met plutôt en cause un déficit pluviométrique structurel qui affecte le taux de remplissage des barrages. La disponibilité de l’eau pour l’irrigation serait ainsi davantage liée aux conditions climatiques qu’à la nature des choix de production agricole. La stratégie se focaliserait par conséquent sur l’optimisation des infrastructures de stockage et la mobilisation de ressources non conventionnelles, dans l’attente d’une amélioration de la pluviométrie.
Les variables d’ajustement d’une équation complexe
Le calcul de l’eau virtuelle, bien que central, ne constitue qu’une partie d’un ensemble de facteurs à considérer. La pertinence du modèle doit être analysée au regard de plusieurs paramètres qui en modulent les conclusions. Le premier est l’intensité et la sévérité de la sécheresse. Une distinction nette doit être établie entre une situation de sécheresse modérée, où les réserves en eau peuvent encore soutenir une production pour l’export, et un scénario de sécheresse sévère. Dans ce dernier cas, avec des niveaux de stockage critiques, la priorité serait réallouée à l’approvisionnement du marché intérieur.
Selon Kamal Aberkani, expert en sciences de l’agriculture, la viabilité du maintien des exportations dépend directement du niveau des réserves hydriques disponibles. Un second paramètre est de nature géopolitique. Le Maroc est intégré dans un réseau d’accords de libre-échange, en particulier avec ses partenaires africains, nord-américain et européens. Ces partenariats sont fondés sur des logiques de complémentarité.
Selon l’expert, une suspension des exportations agricoles pourrait affecter la crédibilité commerciale du pays et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement régionales. Toute décision doit donc tenir compte de ces engagements internationaux et de leurs implications diplomatiques et économiques.
L’intégration des facteurs socio-économiques au calcul
Enfin, l’équation de la politique hydrique agricole doit intégrer une dimension socio-économique fondamentale. Le secteur agricole représente un important pourvoyeur d’emplois et un facteur de stabilité sociale dans de nombreuses régions marocaines. Le maintien de certaines filières de production, même celles consommatrices en eau, peut répondre à un objectif de préservation du tissu économique local et de l’emploi.
L’activité agricole génère également des effets d’entraînement sur d’autres secteurs, comme la logistique, le transport ou l’industrie de l’emballage, ce qui amplifie son impact économique global. L’action publique se trouve ainsi face à un arbitrage permanent entre plusieurs objectifs. Il s’agit de trouver un équilibre entre la performance économique, la gestion rationnelle d’une ressource limitée et la cohésion sociale.
La décision de continuer à exporter l’équivalent de 500 millions de mètres cubes d’eau est mise en balance avec l’option de conserver ce volume pour des usages nationaux, tout en considérant les risques économiques et les pertes par évaporation. Cet arbitrage complexe entre rationalité hydrique, impératifs économiques et cohésion sociale est un élément fondamental de la décision publique, comme le souligne Kamal Aberkani.
Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO