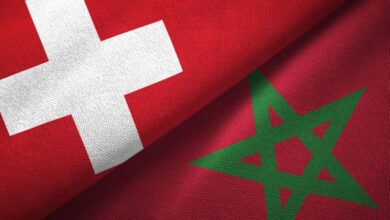Abderrahmane Mounir : “Le numérique doit devenir un pilier du PIB marocain”

Abderrahmane Mounir
PDG DE MAROC DATACENTER
Fort de son parcours entre la Silicon Valley et le Moyen-Orient, Abderrahmane Mounir pilote aujourd’hui Maroc Data Center avec l’ambition de faire du Maroc un hub numérique régional. Dans cet entretien, le dirigeant revient sur l’essor stratégique des data centers, les enjeux de souveraineté numérique, l’impact de l’intelligence artificielle et la nécessité de bâtir un écosystème solide grâce aux partenariats et à l’innovation locale.
Le concept est sur toutes les langues et c’est un outil de souveraineté numérique. Mais peu savent ce que c’est réellement un data center. Pourriez-vous nous expliquer ce que c’est concrètement ?
Un data center est un bâtiment très sécurisé. Il y a la sécurité physique : vigiles, tourniquets, vidéosurveillance.
C’est aussi une forteresse technique avec une très haute disponibilité électrique, avec groupes électrogènes et onduleurs, et un système de climatisation et de lutte contre les incendies. La continuité est primordiale. Même en cas de coupure électrique sur le réseau principal, le data center doit continuer à fonctionner sans interruption. Mais un data center vide ne sert à rien.
Il faut qu’il soit occupé par des équipements informatiques (serveurs, disques de stockage, équipements réseau) qui hébergent les données et les services des clients. Ces équipements nécessitent à la fois sécurité, disponibilité et connectivité haut débit. Maroc Data Center gère à la fois la forteresse elle-même et offre des services cloud en mode Infrastructure as a Service (IaaS) et Plateforme as Service (PaaS)..
Où et comment choisit-on l’emplacement d’un data center ?
Plusieurs critères entrent en jeu : terrain vaste et stable, non pollué et non exposé à des risques comme les inondations, proximité d’une source d’énergie fiable, accès à la haute ou très haute tension pour l’alimentation électrique, présence de la fibre optique avec au moins trois opérateurs télécoms. L’axe Casablanca-Rabat est actuellement le plus stratégique.
Certaines initiatives visent aussi des emplacements hors des grandes villes, notamment pour des usages spécifiques comme les fermes de GPU pour l’intelligence artificielle, qui nécessitent une énergie bon marché.
Que pèse le marché marocain et comment l’adressez-vous ?
Nous adressons tous les segments, du secteur public aux grandes entreprises privées, en passant par des PME. Le marché marocain est encore en maturation. Certains clients ont bien compris l’intérêt de l’externalisation de leur infrastructure, d’autres ont besoin de comprendre. Nous faisons beaucoup de vente consultative pour les accompagner dans leur transformation digitale.
Nous ne sommes pas seuls. Il y a aujourd’hui 7 à 8 data centers privés au Maroc, en plus des infrastructures détenues par des opérateurs télécoms ou des entités publiques. La concurrence est plutôt saine et bénéfique. Elle élargit le marché et incite à l’innovation.
Dans notre métier, l’écosystème est clé. Nous mettons notre infrastructure à disposition d’autres acteurs pour qu’ils proposent leurs services. Par exemple, lors du GITEX, nous avons signé un partenariat avec un acteur de la cybersécurité pour héberger leurs plateformes. Nous collaborons aussi avec OVH Cloud, leader européen, qui s’est installé au Maroc en utilisant nos locaux.
Ces collaborations enrichissent l’offre locale et dynamisent le marché. Nous avons également des participations en Afrique, notamment un très grand data center au Kenya, qui est un hub de télécommunications de l’Afrique de l’Est avec plusieurs câbles sous-marins. Cela justifie un investissement «spéculatif» car le marché est mûr.
Mais notre objectif est de contribuer à la croissance locale, avant de s’étendre. Nous sommes prêts à accompagner le développement numérique du Maroc, notamment à travers des extensions de notre data center. Nous avons identifié des terrains à Casablanca, étudié les capacités énergétiques, et nous restons très agiles pour saisir les opportunités, comme les grands événements sportifs à venir. Notre ambition est claire : accompagner la transformation digitale, la montée en puissance de l’intelligence artificielle, et contribuer à faire du Maroc un hub numérique régional.
L’intelligence artificielle semble être un enjeu majeur. Quel impact aura-t-elle sur le secteur des data centers ?
L’IA est une vraie révolution. Elle nécessite énormément de puissance de calcul et donc d’infrastructure. ChatGPT, par exemple, n’aurait pas pu émerger sans la combinaison de données massives, d’algorithmes avancés et de hardware performant, notamment des GPU spécialisés.
Au Maroc, l’infrastructure IA est encore très limitée. Nous avons quelques GPU, un supercalculateur à l’UM6P, mais c’est insuffisant. De plus, les clients marocains sont réticents à stocker leurs données à l’étranger, ce qui nous pousse à amener ces infrastructures ici. Nous sommes en train d’investir dans ce sens.
Qu’est-ce qui définit la souveraineté numérique d’un pays comme le Maroc ?
La souveraineté numérique repose avant tout sur la localisation physique des infrastructures, notamment des data centers, sur le territoire national. Cela permet au pays de garder un contrôle direct sur ses données sensibles et ses systèmes. Mais ce n’est qu’une première étape. La souveraineté s’étend également à la capacité à gouverner, exploiter et sécuriser ces infrastructures de manière autonome, sans dépendre totalement d’acteurs étrangers.
Pour cela, il faut une gouvernance locale forte, des règles claires, et des opérateurs certifiés capables d’assurer la confidentialité et la résilience des données. Sans cette maîtrise
globale, parler de souveraineté reste
illusoire.
Comment le Maroc peut-il réduire sa dépendance aux technologies étrangères dans le domaine numérique ?
Le Maroc importe la plupart de ses équipements, logiciels et solutions de virtualisation auprès de fournisseurs étrangers, américains, chinois ou européens. Cette situation limite son autonomie et expose le pays à des risques liés à des lois extraterritoriales comme le Cloud Act ou le FISA, qui peuvent contraindre ces fournisseurs à transmettre des données à leur État d’origine.
Pour atténuer cette dépendance, le Maroc privilégie désormais les partenariats avec des éditeurs qui travaillent en mode «open source», qui offrent transparence et accès aux documentations techniques, permettant une gestion plus autonome de la technologie. L’objectif est d’obtenir un meilleur contrôle sur les infrastructures critiques, sans être à la merci d’opérateurs opaques.
Quelles sont les principales mesures pour renforcer la cybersécurité et garantir la souveraineté numérique ?
La cybersécurité est un pilier indispensable de la souveraineté numérique, car les attaques informatiques sont constantes et souvent sophistiquées. Le Maroc a instauré une directive nationale alignée sur les normes internationales, mais la mise en œuvre nécessite encore des moyens financiers accrus et des experts qualifiés.
Sur le plan opérationnel, il faut systématiser les bonnes pratiques comme l’authentification à deux facteurs, des mots de passe robustes, la limitation des droits d’accès et surtout la journalisation des actions (logs) pour pouvoir mener des enquêtes après un incident. Enfin, la sensibilisation des utilisateurs est cruciale, car de nombreuses intrusions résultent de failles humaines plus que techniques.
Globalement, quel rôle peut jouer le numérique dans l’économie marocaine ?
Mon rêve est que le numérique devienne un contributeur important au PIB. Aujourd’hui, il reste encore marginal. Mais avec les data centers, l’IA et le développement des talents, on peut créer une véritable richesse. Le Maroc a un vivier de talents qu’il faut accompagner, former et encourager à innover.
Le pays peut devenir une «software factory» et «cloud factory», un modèle réduit de géants comme l’Inde avec des ingénieurs capables de vendre leur savoir-faire à l’international, créant ainsi un écosystème pérenne et riche. Le numérique est incontournable, quel que soit le secteur. Même pour créer une petite entreprise, il faut consommer du digital. Mon conseil est d’y croire, de se former constamment et de rester à jour, car le digital est au cœur de toutes les transformations économiques et sociales.
Data centers : quels instruments de mesure ?
La certification est cruciale pour garantir la qualité et la fiabilité d’un data center. L’organisme le plus reconnu est l’Uptime Institute, qui évalue plusieurs phases : la conception (design), la construction et l’exploitation. Par exemple, un data center certifié «Tier 3» ne doit pas avoir plus de 1,6 heure de panne par an soit un taux de disponibilité de 99,982%.
Un «Tier 4» ne dépasse pas 26 minutes, soit un taux de disponibilité de 99,995%. Mais la certification ne suffit pas si le data center n’est pas bien maintenu. Un data center peut être construit selon les normes, mais si l’exploitation n’est pas rigoureuse, il y aura des incidents. C’est pourquoi la maintenance et la supervision continues sont des piliers fondamentaux.
Traditionnellement, on mesurait l’importance d’un data center par la surface de sa salle blanche, soit la zone où sont hébergés les serveurs. Notre salle fait environ 300 m². Mais aujourd’hui, la donnée importante est la puissance électrique disponible.
En effet, la consommation des équipements informatiques a explosé. Là où on consommait 4 kW sur 2 m² il y a quelques années, on peut atteindre 40 kW sur la même surface. La puissance électrique détermine donc la capacité réelle d’un data center à héberger des infrastructures.
La performance technologique au défi de la consommation d’énergie
«C’est énergivore. C’est très, très énergivore, surtout avec l’IA». Le constat posé par Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center, résume à lui seul le paradoxe d’un secteur à la fois indispensable à la transformation numérique et fortement consommateur de ressources. À l’heure où l’intelligence artificielle et le cloud explosent, la question de la consommation énergétique devient un enjeu stratégique pour la viabilité économique et environnementale des data centers.
«Consommer de l’énergie renouvelable est une priorité parmi d’autres», précise Abderrahmane Mounir.
Le dilemme est connu : faut-il implanter un centre de données à proximité immédiate d’une ferme solaire ou éolienne, au risque d’être éloigné des pôles économiques et des clients, ou acheminer cette énergie propre à distance ? Au Maroc, la loi 13-09 autorise désormais les opérateurs à acheter de l’électricité verte produite hors site et injectée dans le réseau de l’ONEE, à condition toutefois d’avoir une consommation suffisamment importante, comparable à celle de grandes unités industrielles. Au-delà de l’approvisionnement, la sobriété passe aussi par une modernisation des infrastructures.
«Ce qui consomme beaucoup d’électricité dans un data center, ce sont les serveurs eux-mêmes», rappelle Mounir.
Aujourd’hui, le secteur migre progressivement vers des serveurs plus performants et moins gourmands en énergie. Exemple concret, le passage des anciens disques durs rotatifs, très énergivores, aux disques NVME Flash, compacts comme une clé USB et bien plus efficients. Le refroidissement reste un poste de consommation majeur. De nouvelles solutions existent pour limiter l’impact : le free cooling, par exemple, permet de profiter de l’air frais extérieur durant les mois les plus doux pour éviter de recourir à la climatisation artificielle.
Autre option, les circuits fermés d’eau glacée, qui fonctionnent comme un radiateur de voiture. L’eau est refroidie, circule pour absorber la chaleur des serveurs, puis est récupérée et réutilisée, réduisant ainsi le gaspillage énergétique. La maîtrise de la facture énergétique n’est pas qu’un souci écologique. Elle conditionne directement la rentabilité de l’activité. Et la pression vient aussi du marché. «Il y a des appels d’offres où, si l’on n’est pas inscrit dans la durabilité, on risque d’être exclus», prévient le patron de Maroc Data Center.
Même les partenaires financiers s’y mettent : «Nous discutons avec des banques pour lever des fonds. Nous avons 1% de moins sur les taux d’intérêt si nous prouvons notre engagement durable».
Hicham Bennani, Mariem Ouazzani et Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO