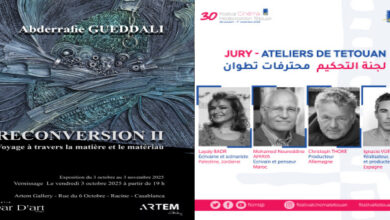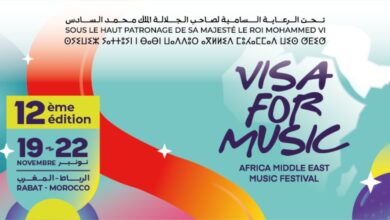Série : “Andor”, les petites gens de Star Wars sous l’empire de Palpatine

Les premiers épisodes de la deuxième saison de la série Star Wars «Andor», avec Diego Luna, Stellan Skarsgård et Genevieve O’Reilly, tiennent leurs promesses. La diffusion a commencé cette semaine, sur la plateforme de streaming Disney+.
Parmi les (trop ?) nombreuses productions de l’univers Star Wars, depuis la reprise de la franchise par le groupe Disney, «Andor» occupe une place à part. La plupart sont hélas insignifiantes ou ratées. Celles de Jon Favreau s’en sortent honnêtement, avec «The Mandalorian» (2019) qui a révélé l’acteur Pedro Pascal, dont le personnage porte pourtant un casque intégral en permanence.
Toutefois, «The Mandalorian» reste un habile western transposé dans un monde interplanétaire. C’est bien fait, mais n’a rien de surprenant. Rien qui soit à la hauteur du choc visuel ressenti par une génération qui avait 10 ou 12 ans lorsque le premier croiseur impérial de l’histoire du cinéma envahissait l’écran par le bord supérieur droit.
Un empire colonial et des «tariffs»
Le vide intersidéral comme nouvel espace de la conquête de l’Ouest est un des fondements de la science-fiction, la colonisation des planètes lointaines, aussi. Et avec «Andor», Tony Gilroy traite de face cette question coloniale, dans les limites de la franchise.
L’univers Star Wars le permet, puisqu’il est sans doute celui qui, sur grand écran, a le plus souvent évoqué le sujet, sans pour autant éviter certains poncifs agaçants. Les «méchants» formant un empire galactique, le sort de l’indépendance des planètes est logiquement l’un des marqueurs de la tyrannie qui s’avance.
Dans l’Épisode V, «L’Empire contre-attaque» (1980), la Cité des Nuages de Lando Calrissian se voit imposer une administration impériale directe et brutale. Cette séquence semble calibrée pour faire vibrer la partie du public américain qui n’aime guère son gouvernement fédéral.
L’autre partie de ce même public souligne, ces jours-ci, que la seconde trilogie (les Épisodes I à III) raconte comment un embargo commercial pour des droits de douane (ou «tariffs», en anglais) a permis au sénateur Palpatine de conquérir le pouvoir et renverser les institutions d’une république galactique millénaire — dont le fameux ordre des chevaliers Jedi.
Du John Le Carré dans Star Wars
Tony Gilroy avait scénarisé en 2016 le long-métrage «Rogue One», où apparaissait pour la première fois le personnage de Cassian Andor. Celui-ci y dérobe les plans de l’Étoile noire, que tente précisément de récupérer ce croiseur impérial au tout début de l’Épisode IV «A New Hope» («Un nouvel espoir»), le premier film Star Wars, en 1977. Gilroy avait préalablement écrit les scénarios des trois premiers films «Jason Bourne» et réalisé le quatrième «The Bourne Legacy» («Jason Bourne : L’Héritage», 2012) ainsi qu’un thriller beaucoup plus personnel, «Michael Clayton» (2007), où George Clooney prenait des airs d’Humphrey Bogart du XXIe siècle.
La série «Andor» raconte comment Cassian Andor va devenir un agent secret de la rébellion, entre les deux premières trilogies, sous le règne d’un Palpatine aux pleins pouvoirs. Gilroy en profite pour faire entrer les codes du thriller d’espionnage, les fonctionnaires de John Le Carré et le suspens de Jason Bourne dans Star Wars. C’est tellement réussi que l’on peut regarder la saison 1 (2022) sans rien connaître de cet univers.
L’œuvre tient par elle-même. Faisant un pas de côté, le show runner met en scène les classes laborieuse, moyenne et grande bourgeoise sous le règne d’un despote intersidéral, qu’il n’a pas besoin de montrer. Il n’y a pas de combat au sabre laser (jusqu’ici). La «Force» cosmique n’est pas même mentionnée : l’ancienne religion jedi ayant été éradiquée par l’Empire, ses derniers tenants se cachent. Bref, c’est la vie du peuple des étoiles sous une techno-tyrannie «impie».
Des personnages déchirés, riches ou pauvres
Au début de la première saison, le jeune Cassian Andor vit de combines pas très claires sur une planète de fiers et solidaires ouvriers ferrailleurs. Le zèle obsessionnel d’un vigile pour l’ordre… sème le désordre. Il précipite l’arrivée des forces impériales, qui décident d’occuper le système.
Sur Coruscant, la planète capitale, les cadres de la police secrète sont d’arrogants fonctionnaires ambitieux, très compétitifs entre eux. Une sénatrice s’investit dans l’humanitaire pour cacher ses activités qui visent à financer un groupe rebelle naissant. Mais un problème de comptabilité l’oblige à envisager un mariage arrangé pour sa fille. Une mésalliance totale, puisque l’autre famille, très riche, est celle d’un parvenu aux méthodes notoirement peu scrupuleuses.
L’ouverture de la saison 2 se fait, notamment, sur les préparatifs de ce mariage et le désarroi de la sénatrice. Très attachée aux libertés, elle culpabilise devant la rigidité aveugle de sa fille, qui s’attache à la lettre des coutumes de leur planète. Son retour aux vieux usages, générationnel, l’empêche de comprendre pourquoi sa mère a le sentiment déchirant de la vendre.
Sur le terrain, Cassian tente de voler un chasseur impérial et rencontre quelques difficultés, dont un groupe de mercenaires pas très intelligents (pour le dire gentiment) et particulièrement indisciplinés. Ils vont mettre en péril une mission aux ramifications bien plus large que leurs puérilités. Les vieux amis de Cassian l’attendent sur une planète agricole. Ouvriers chez les fermiers, sans papiers, ils sont menacés par l’approche de patrouilles de l’Empire.
La saison 1 nous avait montré un état-major impérial planifiant cyniquement la destruction d’un lieu de pèlerinage, sacré pour les habitants de la planète Aldhani. Cette nouvelle saison s’ouvre, aussi, sur un briefing secret du directeur Krennic, qui envisage froidement le déplacement forcé de la population de toute une planète. Le pitch des communicants, qui ont commencé à déshumaniser les habitants dans les médias, marquera certainement les spectateurs attentifs.
Gilroy est célébré pour avoir introduit, non sans humour, une sérieuse dose de réalisme dans Star Wars, évincé le kitsch et tourné de très bonnes scènes d’actions. Il a confié s’être beaucoup documenté, avoir lu «des livres d’histoire et de guerre, sur les rébellions et les révolutions» (l’haïtienne, notamment). Comment naît une résistance galactique, comment les gens ordinaires réagissent à l’oppression technologique, quels sont les choix, bons ou mauvais, qu’ils doivent faire… voilà le sujet de la seconde et dernière saison d’une série qui restera peut-être l’une des dix meilleures de ce premier quart de siècle.
Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO