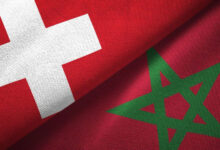Dessalement : un marché en plein essor

Porté par une vision de long terme et des investissements massifs, le Maroc fait du dessalement de l’eau de mer un levier essentiel pour répondre au stress hydrique et accélérer sa transition énergétique. Selon le cabinet Renub Research, la valeur du marché national pourrait atteindre 850 millions de dollars d’ici 2033, confirmant l’ambition du Royaume de s’imposer comme un modèle africain de gestion durable de l’eau.
Le Maroc s’impose progressivement comme l’un des leaders africains du dessalement de l’eau de mer. Face à une sécheresse devenue structurelle et à un stress hydrique parmi les plus élevés du continent, le Royaume a choisi d’investir massivement dans cette filière stratégique, à la croisée de l’innovation technologique et de la transition énergétique.
Selon les estimations du cabinet Renub Research, la valeur économique du marché marocain du dessalement — qui inclut les investissements, la maintenance, la technologie et les contrats de partenariat public-privé — est évaluée à environ 400 millions de dollars en 2024 et pourrait atteindre 850 millions d’ici 2033, soit une croissance annuelle moyenne estimée à 8,74%.
Ces projections, basées sur les tendances d’investissement et les politiques publiques, s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de l’eau 2050, qui vise à sécuriser durablement les ressources hydriques du pays et à diversifier les sources d’approvisionnement. Le Royaume dispose actuellement de dix-sept usines de dessalement en activité, auxquelles s’ajoutent quatre chantiers en cours et neuf projets planifiés. Leur capacité combinée atteindra 1,7 milliard de mètres cubes par an à l’horizon 2033, destinés à la fois à l’alimentation urbaine et à l’irrigation agricole.
Parmi les projets les plus emblématiques figurent ceux d’Agadir, de Laâyoune et de Boujdour, déjà opérationnels, et celui de Casablanca, appelé à devenir la plus grande installation de dessalement d’Afrique, avec une capacité annuelle de 300 millions de mètres cubes. À Dakhla, une station intégralement alimentée par énergie éolienne est en cours de développement, symbole de la stratégie marocaine d’intégration des énergies renouvelables au processus de production d’eau douce.
La question énergétique demeure centrale
Produire un mètre cube d’eau douce à partir de l’eau de mer exige entre quatre et six kilowattheures d’électricité, un coût énergétique important que le Maroc entend maîtriser grâce à son mix renouvelable. L’intégration progressive du solaire et de l’éolien dans les stations de dessalement permet de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de carbone.
D’après une étude de la RES4Africa Foundation et du groupe AFRY, cette synergie eau-énergie pourrait représenter à terme près de 5% du mix vert national. Les récents appels d’offres publics imposent désormais cette exigence d’alimentation propre, attirant des consortiums internationaux tels qu’ENGIE, Abengoa, Acwa Power ou Suez, aux côtés de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Mais l’enjeu n’est pas seulement technologique.
L’eau dessalée coûte encore entre sept et dix dirhams le mètre cube, contre trois à quatre pour l’eau issue des barrages. Sans mécanisme de péréquation ou de subvention ciblée, cette différence risque de peser sur les collectivités locales et sur les filières agricoles, notamment dans les régions du Souss et du Sud. À cela s’ajoutent des défis environnementaux, liés au rejet de saumures — un résidu hautement salin dont le traitement reste complexe. Les chercheurs marocains tentent de développer des procédés de valorisation minérale, notamment pour l’extraction de sels et de métaux à haute valeur ajoutée, mais les applications industrielles restent encore limitées.
Le cadre institutionnel représente un autre point de vigilance. La multiplicité des intervenants – ministères, agences de bassin, collectivités locales – ralentit la coordination et la mise en œuvre des projets. L’idée d’une autorité nationale de régulation du secteur de l’eau est aujourd’hui discutée afin d’assurer une meilleure gouvernance et une planification à long terme.
Malgré ces contraintes, la trajectoire du Maroc reste ascendante. Le pays combine une vision stratégique, des financements internationaux solides — notamment ceux de la Banque mondiale, de la BEI et de la BAD — et une expertise technique en constante progression. En diversifiant ses sources et en couplant eau et énergie propre, le Royaume entend bâtir un modèle durable et exportable pour le continent.
Les moteurs de la croissance du marché marocain du dessalement
Le cabinet Renub Research identifie cinq leviers clés pour expliquer la progression rapide du marché marocain du dessalement, estimé à 850 millions de dollars à l’horizon 2033. La première raison tient à la pression hydrique structurelle : le Maroc est passé d’une disponibilité en eau de 2.500 m³ par habitant dans les années 1960 à moins de 600 m³ aujourd’hui, plaçant le pays en situation de pénurie chronique. Vient ensuite la planification publique, notamment à travers le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, doté de 115 milliards de dirhams, qui donne au dessalement une place stratégique dans les zones côtières d’Agadir, Dakhla et Casablanca. Le troisième levier est la synergie énergétique : selon Renub, l’intégration des énergies solaire et éolienne dans les stations permet une réduction des coûts énergétiques de 15 à 25% et s’inscrit dans l’objectif d’un mix 52% renouvelable d’ici 2030.
Le financement international constitue également un moteur essentiel : les institutions multilatérales, dont la Banque mondiale, la BEI et le Fonds vert pour le climat, accompagnent le Maroc comme modèle d’ingénierie hydrique durable.
Enfin, le secteur privé joue un rôle déterminant via le développement de partenariats public-privé (PPP). Des groupes comme Acwa Power, ENGIE, Abengoa, Suez ou Taqa Morocco participent à la conception et à la gestion des stations sur des durées contractuelles pouvant atteindre 25 ans. Pour Renub, cette combinaison de facteurs dessine un modèle intégré et résilient, où chaque dirham investi produit un effet multiplicateur sur l’économie, l’emploi et la sécurité alimentaire.
H.K. / Les Inspirations ÉCO