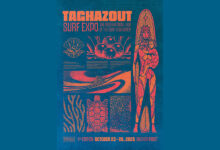Redouane Mrabet : “Il est temps de passer de la réforme à la performance”

Redouane Mrabet
Professeur émérite et ancien président d’université
Dans un contexte où l’enseignement supérieur marocain est sommé de s’adapter aux mutations du marché du travail et aux standards internationaux, Radouane Mrabet, professeur émérite et ancien président d’universités, plaide pour une refonte en profondeur. Diplômes professionnalisants, montée en gamme des formations, partenariats stratégiques et gouvernance rénovée, autant de leviers pour transformer les universités marocaines en véritables moteurs d’innovation et de développement régional à l’horizon 2030.
Masters spécialisés, doctorats appliqués, bachelors professionnalisants, en quoi ces formats répondent-ils aux besoins actuels du marché du travail ?
Tous ces diplômes ne sont pas nouveaux au Maroc. Ils sont proposés depuis une quinzaine d’années par les universités marocaines afin d’offrir des parcours professionnalisants. Toutefois, le nombre d’étudiants inscrits dans ces filières reste faible en comparaison avec le nombre total d’étudiants en formation. Le défi que les universités tentent de relever est d’augmenter ce nombre, tout en offrant des filières qui répondent aux exigences des entreprises nationales ainsi que de celles installées au Maroc.
Par ailleurs, il est essentiel que les entreprises qui recherchent ces compétences s’impliquent davantage dans la formation, notamment en proposant aux étudiants des stages longs et des projets concrets. Elles doivent également participer au développement de la formation en alternance, ce qu’elles font encore très rarement. Je tiens à souligner que ces diplômes professionnalisants sont essentiels pour les entreprises marocaines, car les filières qui y mènent visent à répondre à leurs besoins spécifiques, à améliorer leur compétitivité et à réduire le chômage des jeunes diplômés. Ce qu’il faut, c’est un véritable partenariat entre les universités et les entreprises.
Les diplômes marocains sont-ils suffisamment compétitifs face aux standards internationaux ?
Malheureusement, on reste loin du compte. Les diplômes nationaux ne sont pas encore suffisamment compétitifs, de manière uniforme, face aux standards internationaux. Si certaines formations d’excellence tirent leur épingle du jeu, la majorité du système accuse encore un retard qui limite la reconnaissance et la mobilité des diplômés sur la scène mondiale.
Les grandes écoles de commerce (ISCAE, ENCG), d’ingénieurs (EMI, ENSIAS, INPT) ainsi que les universités privées de renom (UM6P, Al Akhawayn, UEMF), souvent en partenariat avec des institutions internationales, offrent des cursus de haut niveau. Leurs diplômés, bénéficiant d’un enseignement de qualité et de stages à l’international, trouvent plus facilement leur place sur les marchés étrangers. Ces établissements restent cependant l’exception qui confirme la règle. La majorité des diplômes délivrés par les facultés à accès ouvert souffrent d’un manque de reconnaissance. La qualité de l’enseignement y est souvent affectée par la surpopulation, le manque de ressources et des programmes qui peinent à se moderniser.
De plus, le niveau d’anglais de nos étudiants, et même de nos enseignants, reste globalement faible. Cela freine systématiquement le développement de partenariats avec de nombreuses universités internationales en Europe, en Asie et ailleurs. Or, ces partenariats sont indispensables pour accroître les opportunités en matière de mobilité étudiante, de co-diplômation, et de projets de recherche en consortium. Il est donc nécessaire de lancer un véritable «plan Marshall» pour l’apprentissage de l’anglais dans les écoles et les universités du pays. La compétitivité des diplômes marocains doit devenir un chantier structurant, porté à la fois par le ministère de l’Enseignement supérieur et par l’ensemble des universités du Royaume.
Comment les universités marocaines peuvent-elles mieux anticiper les métiers émergents liés au digital, à la transition énergétique ou à l’intelligence artificielle ?
Ce qui est positif dans l’offre de formation universitaire nationale, c’est qu’elle propose déjà des filières que l’on peut qualifier de «front of science». Beaucoup de nos professeurs parviennent à suivre les avancées technologiques et proposent des filières complètes qui traitent de ces avancées ou les intègrent dans des filières existantes. J’ai pu le constater à maintes reprises durant ma longue carrière universitaire.
Cependant, une grande partie des enseignements sont théoriques, car les professeurs sont confrontés au coût souvent onéreux des équipements de laboratoire nécessaires pour offrir aux étudiants un enseignement qui soit également pratique. De plus, les entreprises et les industries du pays, capables de proposer des stages ou des projets de fin d’études de haut niveau technologique, sont peu nombreuses. C’est pourquoi les étudiants qui en ont les moyens partent à l’étranger pour compléter leur formation, soit en utilisant les opportunités offertes par les programmes de mobilité internationale, soit en reprenant une formation qu’ils ont déjà suivie au Maroc.
Pour résoudre cette problématique cruciale, il n’y a pas beaucoup de solutions possibles. Il faut allouer des budgets importants pour l’achat d’équipements technologiques de pointe qui peuvent être utilisés aussi bien pour la formation que pour la recherche scientifique. Un autre «plan Marshall» est nécessaire dans ce cadre. Bien entendu, en parallèle avec cet effort budgétaire, les universités doivent rester proactives, encourager l’innovation pédagogique, tisser des partenariats stratégiques pour la formation continue du corps professoral et assurer une veille technologique constante.
Quel rôle jouent les partenariats internationaux dans la montée en gamme des formations marocaines ?
Il faut reconnaître que beaucoup de formations de bonne qualité – qui existent ou qui ont existé par le passé au Maroc – sont le fruit de partenariats internationaux, notamment avec les universités françaises. Ces partenariats jouent donc un rôle important dans la montée en gamme des formations nationales.
Il faut bien entendu continuer à développer ce genre de partenariats en se tournant vers d’autres pays, sans délaisser notre partenaire principal. Des partenariats triangulaires ou multilatéraux sont nécessaires pour offrir des formations de grande qualité dans les nouvelles technologies, qu’elles soient numériques ou en relation avec des thématiques importantes pour le développement de notre pays.
Par ailleurs, il est important de constater que beaucoup d’universités africaines, essentiellement francophones, essaient de tisser des liens avec nos universités pour que nous puissions les aider à mettre en place des formations qui les intéressent, sachant que les universités du Royaume forment chaque année des dizaines de milliers d’étudiants venant des pays africains avec qui le Maroc a signé des conventions de coopération universitaire. Les partenariats internationaux ne sont plus une option, mais une nécessité stratégique. Ils permettent de combler les lacunes structurelles, d’élever le niveau des formations et de positionner l’enseignement supérieur marocain comme un acteur compétitif et attractif sur la scène régionale et continentale africaine.
Quels leviers structurels devraient être activés pour permettre aux universités nationales de devenir de véritables pôles régionaux de savoir et d’innovation ?
En étudiant le système d’enseignement supérieur marocain, on constate qu’il est basé sur une carte universitaire nationale caractérisée par une redondance des filières et un déséquilibre territorial de l’offre. Pour y remédier, nous proposons la mise en place d’un Schéma directeur territorial de l’enseignement supérieur (SDTES).
Ce schéma stratégique a pour but d’organiser et de coordonner l’offre de formation, de recherche et d’innovation en fonction des besoins spécifiques de chaque région. Inspiré par la loi-cadre n° 51-17, le SDTES permettra de faire de nos universités de véritables moteurs de développement économique régional, d’innovation et d’inclusion sociale.
Dans le cadre de ce schéma, nous proposons de réorganiser les universités «massives» en les scindant en entités plus petites afin d’améliorer leur efficacité et leur gouvernance. À titre d’exemple, l’Université Ibn Zohr pourrait être divisée en quatre universités distinctes situées à Agadir, Aït Melloul, Guelmim et Laâyoune. L’Université Hassan II pourrait être réorganisée en deux universités, l’une à Casablanca et l’autre à Mohammedia…, et ainsi de suite. Nous suggérons également de créer des universités polytechniques sur le modèle de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir.
Ces établissements, spécialisés dans l’innovation technologique et industrielle, seraient créés à Rabat, Casablanca, Fès et Tanger. Ils regrouperaient les écoles d’ingénieurs existantes et introduiraient de nouvelles filières de formation stratégiques pour le développement du pays. Toujours dans le cadre de ce nouveau SDTES, nous insistons sur le développement de campus et d’universités de proximité pour réduire les disparités d’accès. Les provinces de Salé, Khouribga, Nador et Taza seraient prioritaires à court et moyen terme.
Enfin, il est important d’instaurer des Instituts supérieurs spécialisés (ISS) qui viendraient renforcer les universités généralistes et polytechniques. Ces ISS formeraient des cadres hautement spécialisés dans des domaines stratégiques comme le droit des affaires, les arts ou les sciences humaines appliquées. Plusieurs autres politiques, mécanismes et programmes devront être mis en place pour assurer la réussite du SDTES, notamment une autonomie accrue des universités, un cadre législatif clair, des budgets importants et des évaluations périodiques basées sur des indicateurs pertinents et mesurables.
À l’horizon 2030, comment voyez-vous l’avenir des universités marocaines dans un paysage globalisé et hautement concurrentiel ?
L’année 2030 n’est pas très loin, et je ne pense pas qu’il y aura une transformation profonde. Ce que je crains le plus, c’est une stagnation qui rendra les défis actuels beaucoup plus difficiles à relever. Il est absolument nécessaire que notre pays passe d’une logique de réforme à une logique de performance. À plus long terme, quatre scénarios sont plausibles pour l’avenir des universités marocaines dans un paysage globalisé et hautement concurrentiel : deux scénarios positifs et deux autres négatifs.
Le premier scénario, que je qualifierai de pessimiste, prévoit une continuation des problèmes existants, avec une détérioration progressive de la situation des universités publiques, tant dans le domaine de la formation que de la recherche scientifique. Ce scénario, qui souligne l’importance de ne pas rester dans une logique d’inertie, doit être absolument évité pour notre système d’enseignement supérieur. Je le présente pour démontrer la nécessité d’un sursaut collectif que toutes les parties prenantes doivent mener ensemble.
Le deuxième scénario décrit un avenir dans lequel les universités sont confrontées à une multitude de crises qui les forcent à s’adapter de manière souvent brutale, à l’image de la pandémie de covid-19. Contrairement au premier scénario où les tendances actuelles se poursuivent, celui-ci met en scène des ruptures et des chocs qui modifient profondément le contexte et obligent les parties prenantes à réagir. Bien que non souhaitable, ce scénario est probable dans un monde de plus en plus instable.
Le troisième scénario est un scénario optimiste où nos universités mettent en œuvre une transition réussie vers un développement soutenu et durable. La transformation des universités est rendue possible par des investissements importants, une gouvernance plus efficace et une participation accrue de toutes les parties prenantes.
Dans ce scénario très souhaitable, les universités ne sont plus de simples lieux de formation théorique, mais des centres de recherche appliquée, collaborant étroitement avec les entreprises. Des pôles d’excellence voient le jour dans des domaines clés comme la transition énergétique, l’intelligence artificielle et la biotechnologie, formant des profils hautement qualifiés et recherchés. L’enseignement devient flexible et personnalisé, combinant des cours en présentiel, des plateformes numériques avancées et des programmes de formation continue. Les universités marocaines deviennent des destinations de choix pour les étudiants africains.
Le quatrième et dernier scénario est moins optimiste que le précédent, mais les universités commencent néanmoins à devenir des pôles de savoir et sont de plus en plus considérées comme de véritables moteurs de développement économique. Le classement des universités ne cesse de s’améliorer d’année en année. Au moins cinq universités marocaines sont présentes dans le classement de Shanghai et la totalité des universités dans le top 1000 du classement Times Higher Education.
Le fossé avec le marché du travail se rétrécit considérablement et le taux de chômage des lauréats s’établit à des niveaux très bas, en dessous de 7%. Pour finir, le futur de l’université marocaine dépendra de sa capacité à surmonter son retard structurel. À l’horizon 2030, le Maroc a l’obligation de commencer méthodiquement à transformer ses universités en des acteurs du développement et de l’innovation. Cela exigera des décisions audacieuses et un engagement sans faille de toutes les parties prenantes afin que l’un des deux scénarios positifs puisse devenir une réalité.
Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO