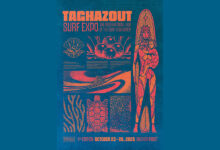Bassin du Sebou : Taounate face au défi environnemental des margines

Chaque année, plus de 176.000 m³ de margine sont produits dans la province de Taounate, soit près de 16% des déchets oléicoles générés dans l’ensemble du bassin hydraulique du Sebou. Ce volume important fait de la région l’un des principaux foyers de pollution liée à la trituration des olives.
La montée en puissance de la filière oléicole, combinée à une gestion souvent insuffisante des effluents, exerce une pression croissante sur les ressources naturelles. Les nappes phréatiques, les cours d’eau et les sols sont exposés aux effets néfastes de ce résidu huileux difficile à traiter. Face à cette situation, les autorités provinciales, les agences hydrauliques et les opérateurs publics s’emploient à renforcer les mesures de contrôle et les infrastructures de dépollution.
Une pression croissante liée à l’essor des huileries
Le nombre d’unités modernes et semi-modernes de trituration de l’huile d’olive a connu ces dernières années une hausse «significative», a indiqué le secrétaire général de la province de Taounate, Boubker Qalouh, lors d’une rencontre de communication consacrée à la problématique de la margine.
De nouvelles unités sont actuellement à l’étude au niveau du comité provincial d’urbanisme et du comité régional unifié d’investissement. Cette dynamique économique entraîne une augmentation des volumes de margine produits, souvent déversés de manière anarchique, en dehors de tout cadre réglementaire. Selon l’Agence du bassin hydraulique du Sebou (ABHS), la quantité maximale de margine produite dans la province atteint environ 176.442 m³ par an.
Parallèlement, le volume total des eaux usées domestiques brutes est estimé à 4,99 millions de m³ par an. La province compte actuellement 95 huileries réparties dans les communes de Ghafsai, Taounate, Tissa, Kariat Ba Mohamed et Thar Souk.
Cette concentration d’unités explique en grande partie la pression exercée sur les ressources hydriques et agricoles locales. Les pratiques de gestion des résidus, souvent empiriques, aggravent cette situation. Le manque d’infrastructures de stockage ou de traitement dans certaines zones rurales contribue également à une dispersion non maîtrisée de la margine dans le milieu naturel.
Stations de traitement et contrôles renforcés
Pour réduire l’impact environnemental de cette pollution, plusieurs investissements ont été réalisés. Trois stations de traitement de la margine ont été mises en place pour un montant global d’environ 97 millions de dirhams, offrant une capacité totale de 153.830 m³ par an.
La première, construite à Taounate par l’ABHS, dispose de quatre bassins et d’une capacité annuelle de 17.000 m³. La deuxième, située dans la commune de Bni Snous et réalisée par l’ancienne Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès (Radeef), peut traiter 88.930 m³ par an. La troisième, implantée à Ras El Oued, atteint 47.900 m³ de capacité.
Ces infrastructures sont complétées par des mesures de contrôle. La commission provinciale a mené 60 visites d’inspection durant la campagne oléicole 2024-2025, donnant lieu à cinq procès-verbaux d’infraction et quatre décisions de suspension d’activité.
Parallèlement, une commission technique provinciale vérifie la conformité des huileries aux cahiers des charges environnementaux. Les contrevenants s’exposent à des sanctions légales pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire des unités. Ces dispositifs témoignent d’un renforcement de la gouvernance environnementale au niveau territorial. L’objectif est de responsabiliser les producteurs tout en consolidant les capacités publiques de traitement et de surveillance, dans un contexte où la filière oléicole joue un rôle économique structurant pour les ménages ruraux.
Sensibilisation et application du cadre légal
Pour Bouchra Boussouari, cheffe du service de la qualité des eaux à l’ABHS, cette mobilisation vise à sensibiliser les propriétaires de moulins aux effets néfastes de la margine sur l’environnement et à les inciter à se conformer aux réglementations en vigueur.
La législation prévoit des dispositions répressives pour les exploitants qui ne respectent pas leurs obligations environnementales. Les margines représentent une menace pour la santé humaine et animale, altèrent la fertilité des sols, dégradent le couvert végétal et polluent nappes phréatiques, cours d’eau et barrages. Les impacts concernent aussi l’irrigation et l’abreuvement du bétail. Le non-respect des normes environnementales entraîne un effet cumulatif sur les ressources hydriques, avec des répercussions durables sur la qualité de l’eau et les écosystèmes.
Cette approche répressive s’accompagne d’actions de formation et de sensibilisation. Des rencontres régulières sont organisées avec les exploitants afin d’expliquer les mécanismes de collecte et de traitement de la margine et les obligations légales associées. L’idée est de créer une dynamique d’adhésion plutôt qu’une logique strictement punitive.
Une action coordonnée à l’échelle régionale
Le directeur général de la Société régionale multiservices Fès-Meknès, Mohamed Chaoui, a souligné que son établissement collabore avec le ministère de l’Intérieur, la Wilaya de la région Fès-Meknès et la province de Taounate pour éliminer les sources de pollution dans le bassin du Sebou. Il a rappelé que les eaux de ce bassin rejoignent celui de Bouregreg via le grand projet d’autoroute hydraulique, ce qui renforce l’importance de cette action.
Cette mobilisation intervient à la veille de la saison de récolte et de trituration des olives. Elle vise à combler les retards en matière d’accès à l’eau potable en milieu rural et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, tout en renforçant la protection des ressources naturelles.
La lutte contre la pollution par la margine s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de préservation du bassin hydraulique du Sebou. Elle repose sur une combinaison de mesures réglementaires, techniques et économiques visant à concilier développement agricole et protection de l’environnement.
Pour les autorités locales, la prochaine étape consistera à renforcer l’interconnexion entre les infrastructures de traitement et les dispositifs de contrôle, afin d’assurer une gestion durable de cette ressource stratégique.
Sami Nemli / Les Inspirations ÉCO