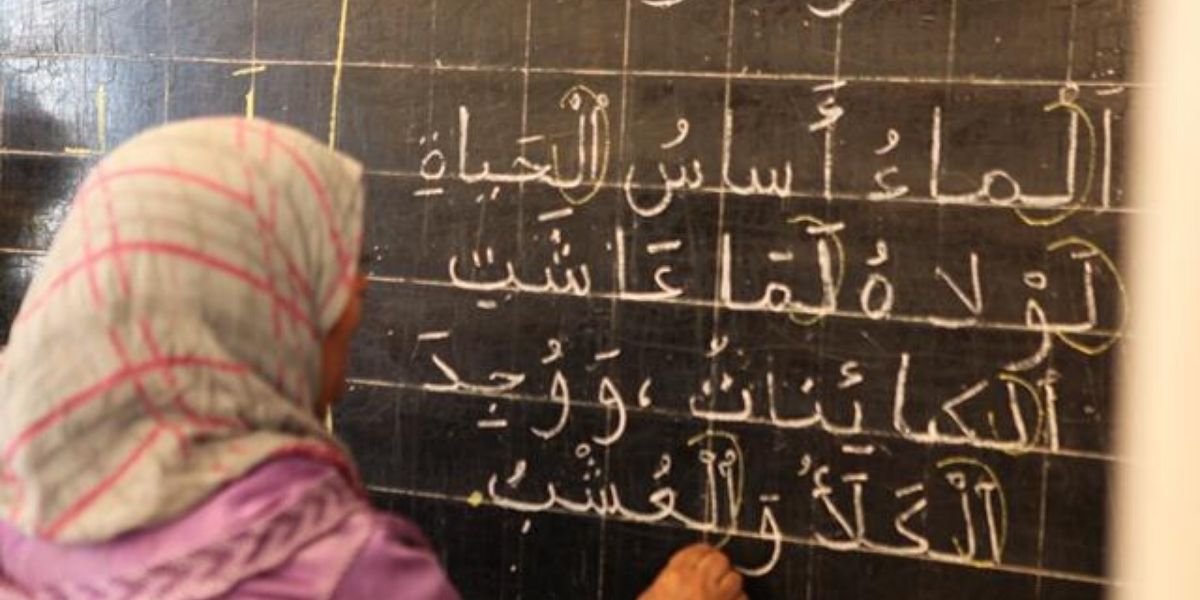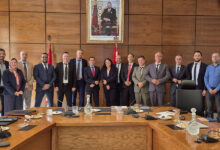Recherche scientifique : le moteur de l’innovation bridé par la bureaucratie

Des millions de dirhams sont alloués chaque année pour stimuler l’innovation dans les universités marocaines, mais une grande partie de ces fonds reste bloquée pendant des mois dans les circuits administratifs. Cette situation conduit à des projets de recherche retardés, des budgets non dépensés et des chercheurs contraints de naviguer dans un labyrinthe bureaucratique qui freine l’ambition scientifique nationale.
La recherche scientifique est reconnue comme le principal moteur du développement et de l’innovation. Pour alimenter ce moteur au Maroc, des financements significatifs sont mobilisés chaque année au profit des projets menés au sein des universités et des centres de recherche publics. Ces fonds proviennent de sources variées, incluant des dotations étatiques, privées et internationales.
Cependant, ce potentiel est confronté à un cadre réglementaire qui freine son élan. Un ensemble de procédures administratives complexes retarde l’accès effectif aux fonds alloués. Ainsi, bien que le moteur de l’innovation soit financé, il se trouve bridé par un appareil bureaucratique qui empêche son plein fonctionnement, créant un décalage préjudiciable entre l’octroi d’un budget et son déploiement sur le terrain par les équipes de recherche.
100% du budget menacé pour les projets courts
Une fois qu’un projet de recherche obtient une validation de financement, une longue démarche administrative débute avant que les équipes universitaires puissent engager la moindre dépense. Les fonds sont d’abord transférés au ministère des Finances, puis dirigés vers la trésorerie de l’institution concernée, comme une faculté ou une école. Le chercheur porteur du projet doit ensuite préparer un document nommé «programme d’emploi», qui détaille la répartition prévisionnelle des dépenses.
Ce document doit être signé par le chef de l’établissement et un représentant du ministère des Finances. Il est ensuite soumis à une procédure de validation appelée «visa». L’ensemble de ce processus, des transferts interministériels à l’obtention du visa final, peut s’étendre sur une période allant de trois mois à une année complète. Durant ce laps de temps, bien que le projet soit officiellement lancé, les fonds demeurent inaccessibles, paralysant de fait le démarrage des activités scientifiques.
Selon plusieurs professeurs chercheurs, les conséquences de ces retards administratifs sont particulièrement préjudiciables pour les projets dont la durée est limitée. Un projet de recherche d’une durée d’un an peut voir sa faisabilité compromise si l’accès aux fonds n’est autorisé qu’après neuf mois.
Les activités planifiées, telles que l’achat de matériel de laboratoire, le recrutement de personnel technique ou l’attribution de bourses à des doctorants, deviennent impossibles à réaliser dans le temps imparti. Les budgets de recherche sont en effet encadrés par une durée de vie stricte. Les dépenses ne peuvent être effectuées ni avant la date de début officielle du contrat, ni après sa date de fin.
Face à cette situation, certains enseignants-chercheurs sont contraints de puiser dans des ressources alternatives ou d’avancer des frais sur leurs fonds personnels pour maintenir leurs activités, notamment pour des déplacements internationaux urgents, en attendant des remboursements qui peuvent eux-mêmes prendre plusieurs mois.
Jusqu’à 40% des fonds non dépensés en fin de projet
Le décalage dans la mise à disposition des fonds a également un impact direct sur l’exécution budgétaire des projets pluriannuels. Dans le cadre de programmes internationaux, le financement est souvent versé en plusieurs tranches. La première tranche, qui peut représenter jusqu’à 60% du budget total, arrive avec plusieurs mois de retard. La seconde tranche, conditionnée à la présentation d’un rapport d’activités à mi-parcours, peut connaître des délais similaires.
«Il arrive fréquemment qu’un chercheur reçoive la dernière partie de son budget, soit environ 40% du total, seulement deux ou trois mois avant la date de clôture définitive du projet», explique un professeur chercheur qui mène des projets financés avec des fonds internationaux.
Il lui est alors matériellement impossible de dépenser des sommes importantes en si peu de temps, tout en respectant les procédures d’achat propres aux établissements publics. L’argent non utilisé à la date d’échéance du contrat est bloqué puis retourné à la trésorerie. Il s’agit d’une perte nette pour le projet et pour l’institution universitaire.
Un cadre réglementaire inadapté et non réformé
La source de ces difficultés réside dans l’application d’une loi de finances générale à un domaine aux besoins spécifiques. Les règles de la comptabilité publique, conçues pour les administrations classiques, manquent de souplesse requise par le rythme des laboratoires de recherche. La gestion par rubriques budgétaires strictes et l’absence de liquidités directes compliquent la gestion quotidienne des projets.
Cette rigidité administrative entre en contradiction avec l’ambition nationale d’accroître la participation des chercheurs marocains aux programmes internationaux, qui exigent agilité et réactivité. En conséquence, une tendance à l’évitement du système public se dessine.
Des chercheurs abandonnent des projets financés par l’État ou se tournent vers des universités privées et des partenaires industriels dont les règles de gestion financière sont plus flexibles. Ce phénomène soulève des questions quant à l’adéquation du cadre réglementaire actuel avec les objectifs de développement de la recherche au sein des institutions universitaires publiques.
Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO