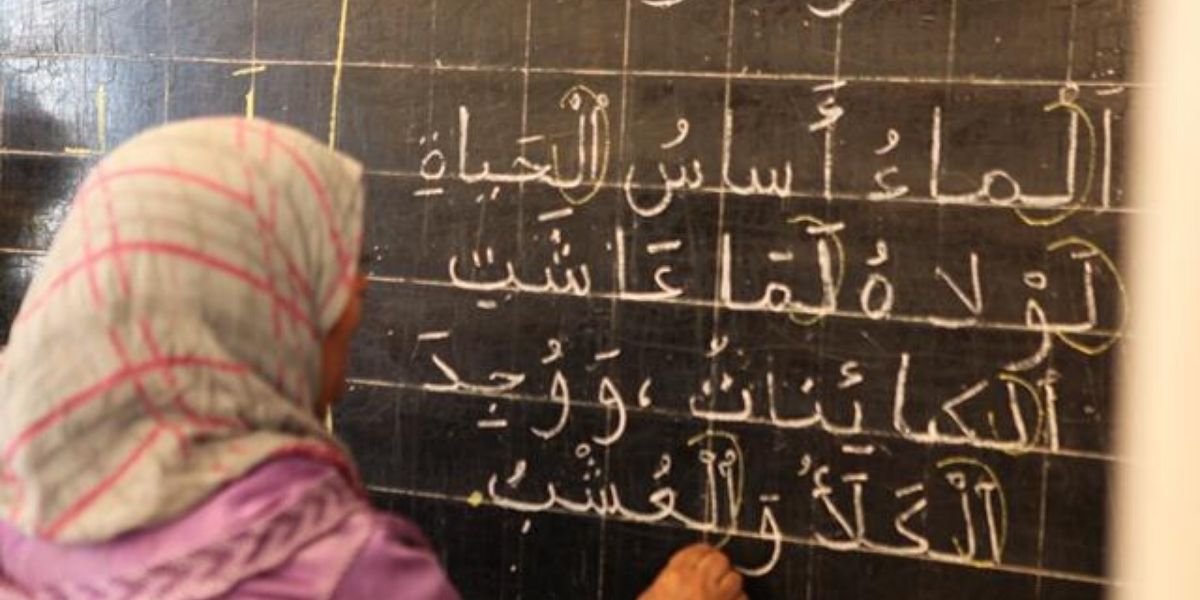Conseil d’administration des CRI : décryptage d’une transformation silencieuse et de ses implications concrètes

Alors que le Maroc accélère sa régionalisation économique, les CRI deviennent les pivots incontournables d’une attractivité repensée. Décryptage d’une révolution silencieuse aux implications concrètes.
Votre prochain investissement régional sera-t-il approuvé en 7,8 jours ? La loi 22-24 dit oui, à condition que les Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI) jouent le jeu… Êtes-vous prêts à investir ? Plusieurs Centres régionaux d’investissement (CRI) ont récemment tenu leur Conseil d’administration (CA), marquant un tournant dans la gouvernance économique territoriale.
À travers ce qu’il en découle, se dessine une refonte systémique impulsée par la loi 22-24 et la nouvelle Charte de l’investissement. Zoom sur ce que révèlent ces instances et leurs implications pour les acteurs économiques.
La loi 22-24 : un cadre légal transformateure
La loi n°22-24, évoquée systématiquement lors des conseils d’administration des CRI de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès et Casablanca-Settat, constitue le socle d’une réforme structurelle.
Comme l’affirme Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, «cette Charte confère aux CRI un rôle renouvelé de guichet unique régional, leur attribuant des prérogatives élargies». Concrètement, la loi opère une décentralisation radicale en transférant l’instruction exclusive des projets aux CRUI, éliminant ainsi les lourdeurs administratives héritées du système centralisé.
Une mutation légale qui se matérialise par une accélération tangible des procédures, illustrée par le CRI de Fès-Meknès où le délai moyen d’examen des dossiers a été réduit à 7,8 jours et le traitement digital des réclamations à 6,7 jours. La loi 22-24 transforme ainsi les CRI en véritables pilotes territoriaux de l’investissement, alignés sur les Hautes orientations royales.
Des résultats économiques tangibles en matière d’attractivité et emploi
Les données révélées lors des conseils d’administration attestent d’une dynamique d’investissement régionale robuste. À Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 363 projets approuvés représentent un volume d’investissement de 43,28 milliards de dirhams et généreront 46.000 emplois dans des secteurs stratégiques (industrie, énergies renouvelables, tourisme).
Dans la région Fès-Meknès, les investissements approuvés atteignent 16,7 milliards – en hausse de 91% par rapport à 2024 – avec 16.453 emplois prévisionnels, soutenus par des projets structurants comme l’extension de 276 hectares du pôle agricole Agropolis et la création de six nouvelles zones industrielles.
Pour les investisseurs, ces chiffres se traduisent par un accès facilité à des zones d’activité aménagées et à des dispositifs incitatifs ciblés, tels que la nouvelle Charte de l’investissement.
Les TPE/PME bénéficient quant à elles de mécanismes de soutien renforcés, notamment en logistique et digitalisation, comme le démontrent les initiatives déployées à Fès-Meknès et Casablanca-Settat. Des résultats qui illustrent une attractivité territoriale en nette progression, directement corrélée à l’opérationnalisation des réformes.
Vers une approche «Customer centric»
Les CRI opèrent une transformation opérationnelle profonde, articulée autour de stratégies territoriales et d’outils digitaux innovants. Celui de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a dévoilé une feuille de route 2026-2028 structurée en cinq axes clés – renforcement de la gouvernance, digitalisation, attractivité territoriale, promotion régionale et facilitation administrative – tandis que Fès-Meknès finalise son plan d’action 2026 pour accélérer la mise en œuvre de la loi 22-24.
Une refonte qui s’incarne dans des projets concrets comme le système d’information territoriale du CRI de l’Oriental, financé par la Banque mondiale, qui, selon le communiqué officiel, «offrira une lecture fine des dynamiques économiques et simplifiera la prise de décision des investisseurs».
Pour les administrations locales, cette digitalisation permet une coordination optimisée via des plateformes centralisées de données, telles que la cartographie des zones d’investissement prioritaires. Les investisseurs étrangers y gagnent un accès en temps réel et détaillé aux infrastructures, ressources et projets en cours, transformant les CRI en véritables plateformes de services intégrés centrés sur l’expérience utilisateur.
Territorialisation des stratégies
Chaque CRI affine désormais son positionnement économique en synergie avec les spécificités locales, créant des écosystèmes différenciés. Celui de Dakhla-Oued Eddahab se consolide comme hub africain spécialisé dans la pêche, l’aquaculture et les énergies renouvelables, attirant des investissements tournés vers le continent.
À Casablanca-Settat, un partenariat stratégique avec l’École nationale supérieure de l’administration (ENSA) vise à former aux bonnes pratiques en gouvernance et accompagnement à l’investissement, renforçant les compétences locales. Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec son ambition d’être la «locomotive de l’économie nationale», prépare 46 projets stratégiques pour 2026 afin de consolider son statut de hub compétitif.
Pour les entrepreneurs locaux, cette spécialisation se traduit par un alignement des dispositifs d’aide sur les filières prioritaires : soutien ciblé aux énergies renouvelables à Dakhla, à l’industrie automobile à Fès-Meknès, ou aux services logistiques à Casablanca. Des stratégies, nourries par des dispositifs d’alerte et d’aide à la décision, qui positionnent chaque région en tant que pôle d’expertise identifiable à l’échelle nationale et internationale.
Enjeux critiques et défis persistants
Malgré les progrès significatifs mis en lumière lors des conseils d’administration, des défis structurels subsistent et requièrent une attention urgente. Dans la région de l’Oriental, un taux de chômage parmi les plus élevés du pays et un déficit chronique en infrastructures économiques et de transport freinent le potentiel de développement, notamment celui porté par le futur port Nador West Med – paradoxe soulignant la nécessité d’investissements compensatoires dans la connectivité territoriale.
En parallèle, la coordination interinstitutionnelle émerge comme un enjeu transversal : l’efficacité des CRUI, pierre angulaire de la loi 22-24, dépend étroitement de la synergie opérationnelle entre les CRI, les collectivités territoriales et les ministères sectoriels. Une interdépendance qui, si elle n’est pas structurée par des protocoles clairs et des plateformes de concertation pérennes, risque de compromettre la fluidité promise par la décentralisation.
Une nouvelle ère pour l’investissement régional
Les récents conseils d’administration des CRI ont acté une mutation historique transformant ces institutions d’anciens guichets administratifs en véritables architectes territoriaux de l’investissement.
Pour les acteurs économiques, cette révolution implique trois changements majeurs : un accès facilité à des services intégrés (via les guichets uniques numérisés), des opportunités ciblées dans des écosystèmes régionaux spécialisés (industrie à Fès, énergies à Dakhla), et une exigence accrue de réactivité face à des procédures désormais accélérées. Comme le résume Yassine Tazi, directeur général du CRI Tanger-Tétouan-Al Hoceima, «l’objectif est d’ériger le CRI en véritable référent régional au service d’un développement économique inclusif et durable».
Ainsi, la pérennité de cette transformation reposera sur l’adéquation entre les stratégies des CRI, les attentes des investisseurs et la résolution des fragilités territoriales identifiées. Une évidence est désormais acquise. La régionalisation avancée de l’investissement, portée par la loi 22-24, n’est plus un slogan politique mais une réalité opérationnelle dont les premiers fruits chiffrés attestent de la viabilité.
Bilali Cherraji / Les Inspirations ÉCO