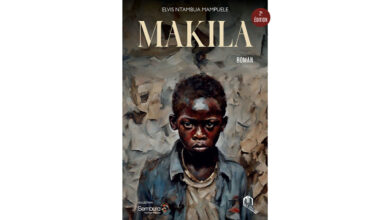Guillermo del Toro. “Le fantastique ne cache rien, le fantastique montre tout !”

Véritable monstre du cinéma mondial, Guillermo del Toro a offert à la 17e édition du Festival international du film de Marrakech une passionnante «Conversation with». Avec des films comme Hellboy, Panic Room, Pan’s Labyrinth ou encore The Shape of Water, il change la vision du cinéma mondial et se fraie un chemin dans l’histoire. Rencontre avec ce génie du cinéma oscarisé et multi-distingué, d’une humilité déconcertante, autour d’un déjeuner en tête-à-tête. Exclusif
Vous avez créé une nouvelle vision du cinéma. Avez-vous toujours su ce que vous vouliez faire comme cinéma ?
Oui…Je suppose que j’ai toujours su. Quand j’étais jeune, je voulais faire plusieurs choses. J’avais plein de choses en tête. Je voulais créer des monstres, mais je ne savais pas ce que la réalisation signifiait. Je n’en avais aucune idée. Je pensais que les films arrivaient comme ça. Que quelqu’un enregistrait une histoire qui se passait «en vrai», dans la vraie vie. Je ne comprenais pas la notion de la réalisation. Mais quand j’ai compris, je me suis rendu compte que la réalisation comportait tout ce que je voulais faire. Je me suis donc orienté en conséquence…
Vous réussissez à rendre les monstres humains. D’où vient cette fascination pour les montres ?
Il n’y a pas de monstruosité sans volonté. La seule façon de devenir un monstre, c’est de choisir de le devenir. C’est ce qui les rend humains dans mes films, vous avez raison. Quand vous voyez un lion, Godzilla ou une force de la nature comme ça, le lion ne se considère pas comme un monstre quand il dévore l’agneau. Il ne fait qu’assouvir sa faim. Godzilla ne considère pas qu’il détruit toute une ville, il ne fait que marcher. Il n’y a pas de mauvaise volonté. Un humain distingue ce qui est bon de ce qui ne l’est pas et fait un choix. Les vrais monstres sont ceux qui font tout ça par choix. On peut tous être des montres. À un moment de la journée, on peut devenir le monstre de quelqu’un. Dans les embouteillages, dans la vie sentimentale…Dans mes films, les créatures qui ressemblent à des monstres ne le sont pas en réalité, et ce sont en général les humains qui sont les monstres…
Il y a aussi un rapport particulier avec le temps dans vos films. Est-ce une obsession ?
Oui ! Et le meilleur moyen de vaincre le temps, c’est de ne pas y penser. Dans Cronos, tout le monde était obsédé par l’immortalité, sauf cette petite fille. La mort n’a pas d’emprise sur elle. Elle est la seule immortelle dans ce film…
La question du temps concerne aussi l’écriture… vous mettez du temps à raconter une histoire. Écrivez-vous de manière intuitive ou êtes-vous plutôt dans la recherche ?
Ça dépend. The Shape of Water, par exemple, a nécessité beaucoup de recherches… Je suis né en 1964 mais j’ai choisi l’année 1962, avant de suivre le premier homme ayant marché sur la lune, avant que Kennedy ne soit tué. Avant que plusieurs choses ne changent les États-Unis pour de bon. J’ai choisi cette période, mais j’avais besoin de savoir ce qui se passait, quelle musique on écoutait, les films de cette époque, le contexte politique. Je mets en moyenne 6 mois pour «designer» un film, 9 mois si c’est un film compliqué. Avec The Shape of Water, on a commencé le design trois ans avant. Le film a mis 5 ans à naître. La créature était tellement importante pour le film qu’elle ne pouvait pas être un acteur. Il fallait la créer de la meilleure façon possible. Pour Pan’s Labyrinth, je suis tombé sur l’histoire d’un prêtre, contemporain de Franco, qui disait aux prisonniers de sa cellule de ne pas s’inquiéter des corps. Ils pouvaient mourir, leurs âmes avaient déjà été sauvées par Dieu. Je l’ai utilisée pour raconter cette histoire…
Vos histoires sont-elles une façon de vous éloigner de la réalité ? À quel point vos films sont-ils personnels ?
Ils sont extrêmes personnels, sinon je ne les aurais pas faits. Vous devez vivre ou faire un film. Si les films étaient aussi importants à raconter, je ferais autre chose de ma vie. Voyager, peindre… Je pense que le fantastique n’est pas capable de cacher la vérité. Le fantastique ne cache pas, le fantastique montre! Dans ce monde, on est d’accord qu’un bout de papier est de l’argent, qu’il y a des frontières entre les pays alors que les satellites n’en montrent aucune, on est d’accord sur tellement de choses qui sont fausses et que l’on considère comme vraies. Alors que le fantastique explore le «vrai» de l’être, nous sommes connectés à des archétypes. Ça, c’est plus vrai que ce qu’il y a marqué sur mon passeport !
Vos films semblent bien vieillir malgré les avancés technologiques enregistrées. À quel point la technologie participe-t-elle à vos efforts créatifs ?
La façon dont on enregistre les images…L’art repose sur la technologie pour faire des films, les distribuer, pour créer l’image. Avant, dans le cinéma muet, on avait besoin de filmer en plein air parce qu’on avait besoin de la lumière du soleil. Petit à petit, on a moins eu besoin de lumière et le son est venu. Aujourd’hui, on peut tourner quasiment sans lumière. On peut même tourner de nuit. La technologie impacte mon travail, c’est évident. Je peux passer par le digital sans utiliser de matériel physique. Par exemple, avant, si je voulais peindre ces bâtiments d’une autre couleur, qu’ils soient bleus au lieu d’être blancs, je devais utiliser une lentille ou un bout de verre devant ma caméra. Aujourd’hui, je peux le faire sur ordinateur, de façon digitale. La technologie impacte mon travail parce qu’elle m’offre plus de possibilités. Le champ est large. À mon avis, on ne doit dépendre de la technologie que si on a quelque chose à dire artistiquement.
Vous formez un trio de choc avec Alfonso Cuarón et Alejandro González Iñárritu. Vous lisez les scripts de chacun, vous vous conseillez mutuellement… Vos scripts changent-ils beaucoup, après lecture de vos confrères ?
Généralement, on s’échange les scripts lorsqu’ils sont presque scellés, mais je me souviens que, lorsque Alfonso m’a envoyé le scénario de «Y tu mama también», l’histoire avait une fin différente avec les trois se dirigeant vers la mère. Je lui ai proposé la scène du baiser. Alfonso a pensé que c’était une bonne idée. Il l’a ajoutée. On a aussi parlé du fait de ne pas la montrer en train de se suicider. Il a aussi changé cela. Quant à Alejandro, en lisant The Shape Of Water, celui-ci m’a proposé de changer les films que le personnage de Sally regardait au cinéma. J’avais écrit qu’elle regardait des classiques comme Singing in the Rain. Pour Alejandro, ce personnage regardait les films «pour les regarder», il n’y avait donc pas besoin de montrer des classiques, au contraire. Il pouvait s’agir de mauvais films. Elle était fascinée par l’image. Elle aime tous les films! Et j’ai trouvé que c’était bonne idée, j’ai changé.
Dans votre filmographie, quel est le film le plus personnel? Êtes-vous Hellboy ou encore Carlos, dans L’Échine du Diable ?
Un peu de chaque, je pense. Les plus petits films que j’ai faits parlent à une partie de moi, tandis que les grands s’adressent à une autre. Hellboy est très biographique, je m’identifie beaucoup à Hellboy. Enfin, je m’identifiais beaucoup, plus maintenant. J’ai changé depuis. The Shape Of Water, Pan’s Labyrinth, Cronos sont très intimes, très personnels aussi.

Est-ce que l’Oscar change quelque chose dans la façon de créer ou de penser un autre film ?
Non je ne pense pas… Je ne l’ai pas remarqué en tout cas. Dans mon processus de création, je ne me souviens même pas que je l’ai eu, je n’y pense pas. Cela change peut-être inconsciemment les choses, mais je n’ai rien remarqué. Je ne me pose jamais la question de ce que les gens vont penser, de toute façon…
Dans toute votre filmographie, l’émotion est palpable. Vos films ont un pouvoir émotionnel assez impressionnant…
Dans tous mes films, il y a un moment ou un autre où je pleure. Je ne peux pas m’en empêcher. Dans tous mes films, je passe par plusieurs étapes, je suis heureux, triste, en colère. En tant qu’artiste, il y a toujours un moment où l’on va sentir l’inspiration du peintre ou la note parfaite du musicien. La différence, c’est que le réalisateur le fait entouré de 200 personnes alors que les autres sont seuls. Mais on apprend à ressentir cela. On apprend à déterminer le bon geste de la caméra, à voir si l’acteur a joué la scène comme il le fallait. Mais des fois, avec tout cela, les films sont mal reçus et des personnes n’aiment pas votre œuvre. C’est très blessant. Mais ce n’est pas grave, parce que le film est émotionnellement le vôtre. Et ça, personne ne vous l’enlèvera…
Vos films sont une musique, une musique silencieuse. Comment travaillez-vous cette musicalité des plans, des scènes, même dans le silence ?
Un film a quelque chose de symphonique. Son montage, le fait de couper, ce sont les percussions. C’est ainsi qu’on donne un rythme au film. La mélodie est le mouvement de la caméra, les gestes des acteurs. Et la combinaison de ces deux éléments donne de la musicalité à un film. Un film est une mélodie. Et quand on chorégraphie la mélodie, la différence entre une danse et une autre est importante. Idem pour la différence entre un mouvement de caméra et un autre, le choix d’une lumière ou d’une autre. Il n’y aucun choix sans conséquences.
Vous êtes une inspiration pour un grand nombre de jeunes réalisateurs. Quels sont vos modèles ?
Buñuel et Hitchcock, je pense. Fellini, Welles sont aussi parmi mes préférés! Je les aime parce qu’ils sont incompris aussi. L’art s’adresse à une partie intime de notre être. La sculpture demande le toucher, le théâtre demande une distance avec l’audience. La musique et le cinéma s’adressent à l’intime, au corps directement. Ça fait vibrer le corps.
Connaissant l’artiste que vous êtes, on imagine que votre tête grouille d’idées, d’histoires à raconter. Comment faites-vous le tri entre toutes ?
On sent quand c’est le bon moment. C’est toujours une histoire d’instinct. Quand est-ce que c’est le bon temps, pour vous, de raconter une histoire? Un film n’est pas un rendez-vous galant, c’est un mariage. On donne au moins trois ans de notre vie à un film. On vit avec un film. La décision repose sur l’argent. D’où vient l’argent? Et à chaque fois, je me demande si je dois le faire avec un budget restreint pour avoir plus de liberté. Et la réponse à cette question devrait toujours être oui !
Guillermo Del Toro se soucie-t-il encore du financement de ses films ?
Bien sûr! Il y a peut-être quatre réalisateurs dans le monde qui ne s’en soucient plus: James Cameron, Steven Spielberg, Peter Jackson et George Lucas. C’est tout. Le reste se bat constamment pour l’argent. Le financement d’un film. On doit convaincre les acteurs. Pour The Shape Of Water, on nous a donné la moitié du budget… et on l’a fait! Personne n’a voulu risquer de mettre de l’argent. Il faut comprendre que l’argent n’est pas réel, ce sont les images qui comptent… La plupart des gens pensent que The Shape Of Water a nécessité un budget dingue. Ce n’est pas le cas. On a rusé pour faire ce film. L’argent compte peu, finalement…