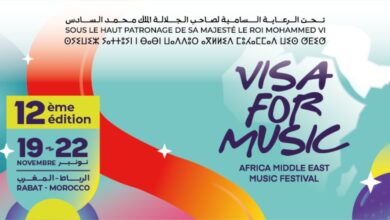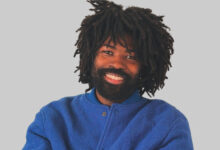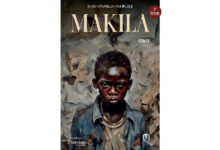Cinéma : les 4 Fantastiques refont leurs premiers pas

En salle cet été, le reboot des 4 Fantastiques, aux images léchées, laisse comme un goût d’inachevé.
Créés par Stan Lee et Jack Kirby, Les 4 Fantastiques ont vu le jour en 1961. Les deux auteurs ont estimé que ces personnages étaient avant tout des gens comme les autres — et des super-héros seulement dans un deuxième temps.
Dans le contexte de la Guerre froide, l’Amérique aimait à rappeler la «superpuissance» des citoyens ordinaires de la classe moyenne. Cette série a donné naissance à l’une des bandes dessinées Marvel parmi les plus marquantes, esquissant les contours de l’Univers Marvel qu’on connaît aujourd’hui.
Chaque décennie, de nouveaux numéros mettant en scène nos quatre super-héros ont été publiés, représentant un total de plus de 700 aventures depuis leur création.
Un nouveau reboot
«Les 4 Fantastiques : premiers pas» est la troisième adaptation des aventures des super-héros Marvel sur grand écran, après le diptyque de Tim Story au milieu des années 2000 («Les 4 Fantastiques» et «Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent») puis le long-métrage de Josh Trank en 2015 («Les 4 Fantastiques»).
Avec «Les 4 Fantastiques, premiers pas», Marvel lance un nouveau reboot, qui s’inscrira dans le MCU. Les rôles de Mr Fantastique, Susan Storm, la Chose et la Torche Humaine ont été attribués, respectivement, à Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn.
Si les bandes dessinées étaient portées par l’esprit des années 1960, ce nouveau film voulait clairement retrouver l’émerveillement, l’ambition et l’espoir d’un avenir meilleur, propres à cette époque. La direction artistique est remarquable et les images très soignées remettent au goût rétro-futuriste les télévisions à tubes cathodiques et ce scientisme naïf qui croyait que la conquête spatiale allait tout expliquer.
Cependant, les années 60 sont aussi célèbres pour avoir été la décennie des grandes remises en question, des luttes anticoloniales et des mobilisations pour les droits civiques. Or, ces aspects de l’époque sont totalement absents de l’écran, alors qu’on les retrouve dans bien des comics d’alors. Le résultat est que la dimension purement esthétique fait très artificielle.
Un univers particulièrement vide
À la différence du «Superman» de James Gunn, par exemple – toujours sur les écrans -, cette recherche d’une «simplicité d’antan» se caractérise ici par des personnages sans profondeur. Il est souvent pénible, durant le film, de voir de si bons acteurs trahis par un script indigent.
Pedro Pascal en est réduit à cabotiner ostensiblement, mais sans joie, tandis que Joseph Quinn — censé être littéralement tout feu tout flamme — reste constamment bridé par une psychologie inexistante. Curieusement, Ebon Moss-Bachrach a droit à un rôle un peu mieux écrit, alors qu’il est réduit à une CGI (Computer graphic image) ambulante.
À Vanessa Kirby, quant à elle, est confiée la nécessité de jouer un accouchement dans l’espace — qui ne marquera pas les écrans comme celui d’«Alien». Autre grande faiblesse de ce scénario, il est assez surprenant que ces 4 Fantastiques soient présentés avec un building, un vaisseau spatial — dont le pas de tir est à Manhattan même — et dictant leurs conditions à la planète entière, sans qu’un seul mot ne vienne préciser si l’argent que cela demande vient du privé ou du public. Que l’on aime ou pas, les films d’Iron Man, pour prendre un autre exemple comparable, traitaient brillamment de ces relations problématiques.
Une famille en plastique
La production revendique avoir voulu mettre en avant la notion de famille. Pour le producteur exécutif Grant Curtis, le fait que les 4 Fantastiques forment une famille les distingue de façon très nette des autres super-héros. Il confie : «L’Univers cinématographique Marvel (MCU) a déjà exploré les enjeux familiaux avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Cependant, ici, la situation est tout autre, car il s’agit avant tout d’une famille de sang autour d’un frère, d’une sœur, d’un mari et de sa femme, et de leur meilleur ami de fac.»
La famille est certes très importante, mais ce long-métrage ne prend pas en considération tout ce que la littérature, le cinéma et aussi la bande dessinée ont déjà exploré dans son domaine. Ses problèmes, par exemple, sont souvent beaucoup plus complexes que de rares chamailleries entre deux beaux-frères pendant la préparation du petit-déjeuner.
L’ensemble de ces faiblesses laisse donc un désagréable arrière-goût de plastique creux. Et ce serait insulter la bande dessinée que d’en imputer la responsabilité au genre. Toutefois, les «dévoreurs de mondes», venus de l’espace ou pas, feraient bien de ne pas sous-estimer la colère d’une jeune mère défendant son enfant. Sur ce point, tout le monde sera d’accord.
Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO