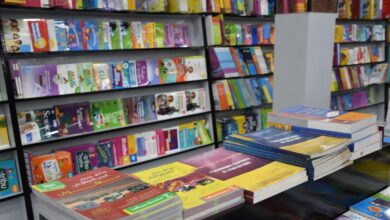L’aquaculture «rame» à l’export

Le marché mondial de l’aquaculture connaît une forte croissance, ce qui offre des opportunités importantes pour la filière marocaine. Mais cette dernière, en dépit de son grand potentiel, fait face à de nombreuses difficultés qui freinent son développement.
«Ce secteur s’est heurté à de grandes difficultés, aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau de ses débouchés externes, entravant sérieusement son développement et sa survie». C’est le constat que dresse la Direction des études et de la prévision financière (DEPF), dans une étude fraîchement publiée et intitulée «Potentialité de l’aquaculture dans la dynamisation des exportations marocaines des produits de la mer». Alors qu’elle est devenue l’un des secteurs majeurs de la production alimentaire mondiale pour répondre à la demande en produits halieutiques de plus en plus accrue, l’aquaculture marocaine peine à décoller. La production aquacole ne représente pas plus de 0,1% du total de la production halieutique nationale, avec un volume de production annuelle moyenne ne dépassant pas 400 tonnes. Néanmoins, la filière présente un potentiel important et des opportunités intéressantes à l’export. La consommation des produits halieutiques ne cesse d’augmenter et l’aquaculture contribue, de manière croissante, au commerce international des produits halieutiques, en fournissant des espèces telles que le saumon, le bar, la dorade, les crevettes et le bouquet, les bivalves et d’autres mollusques, mais aussi des espèces à faible valeur, comme le tilapia, le poisson-chat et la carpe. La DEPF, en examinant des opportunités de commercialisation à l’échelle mondiale des produits ciblés par la stratégie aquacole marocaine, constate qu’il y a des parts de marché à prendre à l’international. Pour cela, toutefois, il faudra surmonter plusieurs obstacles.
Contraintes
Le constat est qu’en effet, le secteur aquacole marocain s’est caractérisé, ces dernières années, par une baisse importante d’une production déjà faible auparavant et par une réduction du nombre d’entreprises aquacoles en activité. Cette régression s’explique, en grande partie, par les difficultés auxquelles fait face le secteur aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, qui entravent sérieusement son développement et sa survie. Les problèmes environnementaux, résultant d’une gestion inappropriée des sites d’élevage, viennent en premier. Selon la DEPF, des contaminations métalliques ont été constatées dans plusieurs lagunes, notamment celle de Khnifiss et de Oualidia. Les normes sanitaires sont aussi des restrictions qui freinent l’export. La conchyliculture (huître plate et palourde européenne) a été très affectée par les mesures de restrictions sanitaires européennes, adoptées depuis la fin des années 80 et qui ont été à l’origine de la limitation des quantités produites. À cela, s’ajoute la concurrence acharnée que connaît le marché international. Les produits aquacoles marocains sont marqués par une faible compétitivité face à la forte concurrence sur le marché mondial exercée par des concurrents puissants ayant bénéficié, en particulier, d’aides publiques notamment en Europe. Autre difficulté, et non des moindres, les contraintes à l’investissement. L’aquaculture est, en effet, une activité fortement capitalistique dans la mesure où la mise en place des unités de production exige des travaux d’aménagement et de viabilisation des sites ainsi que des équipements importants, ce qui induit des coûts, à l’entrée, considérables. Ajoutons à cela le cycle de production pour ces activités qui est relativement long avec une commercialisation de la production qui n’intervient qu’après 2 ou 3 ans du démarrage du projet.
Recommandations
Ainsi, il est nécessaire de promouvoir la conservation et la planification des côtes et des terres continentales pour une exploitation rationnelle des ressources. Pour la DEPF, la préparation de plans d’aménagement intégré des zones côtières, surtout dans les pôles de développement de l’aquaculture, s’impose avec acuité pour mieux apprécier les potentiels et assurer une exploitation durable. Le renforcement des moyens financiers de la filière est aussi l’une des priorités. Le soutien financier direct aux opérateurs du secteur privé, en tant qu’exploitants aquacoles et en tant que fournisseurs d’aliments pour l’aquaculture, est vital pour le processus de lancement de projets d’aquaculture.
Ce soutien devrait inclure la mise en place d’un programme de microfinancement pour les plus petits opérateurs et des financements à des taux d’intérêt raisonnables. Aussi, l’encouragement des investissements étrangers et des partenariats entre les investisseurs étrangers et les entrepreneurs locaux est de nature à renforcer le financement de l’activité aquacole et le transfert de l’expertise technique et de gestion. La DEPF suggère aussi de diversifier les marchés pour garantir la durabilité à l’aquaculture. La diversification des débouchés devrait être basée sur des stratégies d’inspection des marchés, en se concentrant sur l’étude de leur potentiel et leur promotion.
Enfin, le modèle de développement de l’aquaculture marocaine devrait être adapté à ses propres ressources et à ses conditions spécifiques. Les ressources hydriques, les coûts de production et les structures de prix, les marchés, n’étant pas les mêmes que dans d’autres pays concurrents (la Chine, le Viêt Nam, la Norvège, le Chili, la Grèce, la Turquie et l’Égypte), le Maroc devrait, dès lors, concevoir son propre positionnement en tenant compte de ses potentialités et de son ambition à moyen et long termes.