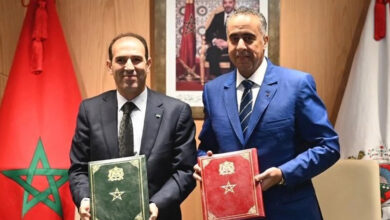Immobilier locatif : totale anarchie !

Dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat, se loger en période estivale relève souvent du parcours du combattant. Faute de cadre réglementaire clair, le marché locatif demeure sous l’emprise d’un réseau informel structuré, qui dicte ses propres règles, en l’absence d’une régulation très attendue par les professionnels.
Louer un appartement ou un studio à Casablanca en été n’a rien d’une sinécure. Certes, la métropole ne connaît pas, à proprement parler, de saison estivale aussi frénétique que celle des stations balnéaires comme M’diq, Agadir ou Saïdia. Mais l’été y crée tout de même un pic temporaire, alimenté par le retour des Marocains résidant à l’étranger et les séjours de familles en transit ou de cadres en mission. Dans la métropole, les quartiers périphériques comme Bouskoura, Dar Bouazza ou encore Sidi Maârouf se transforment alors en zones de tension.
Pourtant, l’offre, bien que réelle, demeure largement hors de portée. Faute d’annonces structurées, la mise en location échappe aux circuits formels, tandis que les agences traditionnelles, débordées, peinent à absorber la demande.
«Aujourd’hui, près de 40.000 logements demeurent vacants, non pas faute de demande, mais par prudence. De nombreux propriétaires préfèrent ne pas louer de peur de ne pas être payés. Cette situation crée une tension artificielle sur l’offre», confie Mohamed Lahlou, président de l’Union régionale des agences immobilières.
C’est dans ce vide opérationnel que s’installent les véritables maîtres du jeu, les «samsara» figures discrètes mais incontournables du marché locatif.
Les «smasria», plaque tournante du marché
À défaut d’une régulation étatique, c’est une forme d’organisation parallèle qui s’est imposée au fil de l’eau. Les samsara, ces agents de quartier sans statut ni carte professionnelle, constituent une toile d’intermédiaires parfaitement tissée. Ils circulent entre les immeubles, les cafés, les garages ou les supérettes. Ils savent, souvent avant tout le monde, qui déménage, qui cherche, qui vend…
Ce qui peut sembler, à première vue, un simple système D, s’apparente en réalité à un réseau informel structuré, où chacun opère dans une zone d’influence bien délimitée. En échange d’un mois de loyer, voire d’un simple pourboire, ils se font forts de mettre en relation propriétaires et locataires, négocient fermement, avant de… disparaître au moment de la conclusion du contrat, si contrat il y a ! Le tout sans trace écrite, sans garantie et sans recours éventuel en cas de litige.
«Les samsara ont une bonne connaissance du terrain. Leur force réside dans leur capacité à organiser l’offre en amont, bien avant qu’elle ne soit visible », confie un spécialiste de la location.
Si les pratiques varient selon les quartiers et le profil de l’acheteur, une règle tacite s’est imposée, nous explique les professionnels, à savoir le versement de la commission d’intermédiation, laquelle équivaut généralement à un mois de loyer. Dans la réalité, les écarts sont fréquents.
À Hay Riad ou à l’Agdal à Rabat, comme dans certains quartiers tels que Maarif ou Gauthier à Casablanca, les intermédiaires informels adaptent leur rémunération à la rareté de l’offre et au profil du client. Force est de constater qu’aucune instance ne supervise concrètement leur activité, et le cadre légal censé en régir les pratiques demeure en suspens. En effet, le projet de loi, annoncé en 2014 pour encadrer le métier d’agent immobilier, dort toujours dans les tiroirs du Secrétariat général du gouvernement. En attendant, l’anarchie perdure. Et les locataires en font les frais.
Face à ce désordre «assumé», les agences immobilières professionnelles proposent une alternative plus formelle — mais pas toujours accessible. Leur modèle repose sur la transparence contractuelle et l’évaluation rigoureuse des dossiers. Cela suppose un formalisme rigoureux (bulletins de salaire, caution, garanties bancaires), ce qui est de nature à rassurer les propriétaires… mais freine nombre de locataires.
Certes, la pression locative estivale retombe dès septembre. Mais elle met en lumière les fragilités structurelles du marché et expose l’écart croissant entre offre formelle et demande. Alors que l’État s’apprête à déployer une politique d’aide directe à l’accès au logement, la question du canal de distribution reste entière. Car en l’absence d’un encadrement transparent des pratiques d’intermédiation, c’est toujours à la marge que se négocie l’accès au logement.
Ayoub Ibnoulfassih / Les Inspirations ÉCO