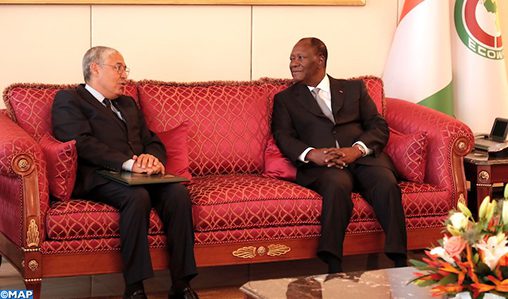Avant-première mondiale de «Headbang Lullaby» : Dans la tête «DUR»de Hicham LASRI
Le Maroc était bien présent à Berlin, dans la section «Panorama» avec le dernier opus de Hicham Lasri : «Headbang Lullaby» («Darba fa rass») en avant-première mondiale. Une fresque aussi absurde qu’attendrissante où le réalisateur nous raconte un Maroc des années 80 qu’on aurait presque oublié.
La Coupe du monde de 1986, l’attente presque inespérée de Hassan II, un flic, un moqadem, des allumettes «sab3», des situations presque burlesques, une belle dose d’humour et des références fortes sur fond de musique punchy et décalée, telles sont les images du film «Headbang Lullaby» («Darba fa rass») de Hicham Lasri qui fait l’effet d’un coup sur la tête.
Le premier plan plante le décor d’un film presque surréaliste d’une société souvent absurde et surréaliste. «Dans tous mes films, il y a une part d’absurde. Notre société est si absurde que les gens ne la voient même plus. Cette absurdité est perméable. Je suis de Casablanca, je ne peux pas vivre ailleurs, mais à force d’être dans un endroit, on est inhibés, saturés par l’information, on ne reçoit plus rien, on n’a plus d’empathie», confie le réalisateur et scénariste qui suit ses personnages et se laisse porter par leur force, leur magnétisme. Daoud, joué par un Aziz Hattab bluffant, qui signe l’un de ses meilleurs rôles, est un policier blessé à la tête (avec une plaque de fer dans la tête) qui est envoyé sur un pont, un nouveau pont qui va voir passer le roi. C’est le jour d’un match important, celui de la Coupe du monde de 1986 qui a laissé le Maroc en émoi. Cette série d’évènements va pousser des gens du village Coca et du village Bipsi à faire des choses inattendues. «Je ne suis pas engagé, je ne fais pas de politique. Mon film est plein de tendresse. Les Marocains sont touchants, ils sont heureux quoi qu’il arrive. Quand ils n’ont pas de dents, ils rient quand même», continue le réalisateur qui voulait montrer un film d’un Maroc qui n’existe plus, qu’on a essayé d’effacer, montrer à des gens de tous les continents ce qu’on est. Une société multidimensionnelle à plusieurs vitesses mais qui se perd souvent, parfois incomprise et qui ne se comprend pas elle-même.
Le réalisateur joue sur les non-dits, les peurs, les insécurités du Marocain et les révèlent au grand jour, laissant le public juger du décalage de ces personnages. La peur irrationnelle de l’autorité, l’abus de pouvoir. Ils parlent des détenus politiques et de cette incapacité à en parler ou à mettre un nom sur la situation. À cette détresse des familles qui ne comprennent pas et qui doivent vivre avec ou continuer à vivre comme si de rien n’était. À ces deux villages «rivaux» sans problème qui voient le «makhzen» arriver et qui se battent pour l’avoir dans son camp. «Il faut prendre des risques. Je ne fais pas des films pour fédérer, pour plaire à tout le monde. Je déteste le cinéma tiers-mondiste. Je déteste l’idée que parce qu’on vient d’une région du monde, on est obligé de faire un type de cinéma. Les gens peuvent dire des choses difficiles en étant heureux». Tel est le cas de ces personnages qui n’ont rien et sont heureux. Le Moqadem de «Coca» joué par un Benaissa El Jirari convaincant et drôle, qui ne vit que pour voir passer la voiture de Hassan II sur le pont. Une joie perturbée par l’accident d’un des policiers qui se voit faire irruption dans un village secoué par l’idée d’avoir une telle responsabilité sur le dos. Les paris sont ouverts : est-ce qu’il faut l’aider ou pas ? Est-ce qu’on peut toucher un flic en attendant une ambulance qui mettra des heures à arriver ? Même l’assistance à personne en danger est débattue par peur. La peur, la soumission, des acteurs principaux du film. «Ces gens-là ont le monde autour d’eux mais ne le regardent pas. On a été éduqués pour être comme cela. Baisser la tête. Personne ne lève les yeux. C’est synonyme de respect, de crainte, de plein de choses qui ne disent pas leur nom». Un film sensoriel, qui sort tout droit de la tête pas toujours très saine de ses personnages. Latefa Ahrrare est incroyable dans ce film, tout en démesure et en justesse, le jeune Zoubir Aboulfadl, 10 ans, a une belle carrière d’acteur devant lui. Une fresque décalée à l’image de notre société souvent surréaliste. Des acteurs que l’on redécouvre, qui semblent comme des poissons dans l’eau devant la caméra de Hicham Lasri. Selon lui, Aziz Hattab et Benaissa El Jirari avaient peur des rôles. Il se souvient de ses acteurs dans d’autres films. «Hassan Badida et Malek Akhmisse ne savent pas nager, des fois je demande à mes acteurs de se surpasser, de faire des choses qui vont à l’encontre de leur propre survie. C’est dangereux de pousser quelqu’un à l’extinction. La caméra n’est pas une machine, c’est un détecteur de mensonges». D’où l’importance et la sincérité des personnages à travers qui on vit le film. La musique composée par Wissam Hojeij est presque un acteur principal vu que le réalisateur a pensé le film comme une comédie musicale, ce qui lui donne une dimension encore plus décalée au film.

Le geek émotif du cinéma marocain
Qui dit film décalé, dit réalisateur décalé. Et heureusment ! Dans tous ses films, Hicham Lasri a habitué à l’absurde. Il le montre dans «C’est eux les chiens», «The sea is behind», «Starve your dog», le cinéaste marocain avait déjà planté le décor d’un cinéma audacieux. «Le cinéma, ce n’est pas un écran, c’est un écrin ! Au cinéma les gens ont le temps de se poser des questions, avoir leur vision du film. En télévision, il n’y a pas le temps, il faut être percutant. Cette simplicité est quelque chose de difficile à avoir. Je suis encore à la recherche de son épuration, je fais des progrès mais je travaille encore sur cela. Comment filmer le Maroc en filmant son vrai visage sans indignation, ni jugement. je m’investis énormément émotionnellement, je veux que les gens le ressentent», confie le réalisateur. Pourtant, «le film a eu l’avance sur recettes. Nous avons eu un souci sur la quatrième tranche. Le CCM fait son travail, la commission est indépendante. Je trouve cela injuste des fois mais je préfère aller de l’avant, trouver des solutions. Ce qui m’a dérangé, c’est qu’on ne nous a pas donné de raisons. Mes autres films n’ont pas été financés par l’État parce que j’avais besoin d’être sur un autre rythme», continue le cinéaste marocain qui a reçu une aide du Liban, de la France, même de Grande-Bretagne où il n’a jamais tourné. Pour Lasri, plus que de l’argent, c’est le soutien qui ne se trouve pas. D’ailleurs, le réalisateur et son équipe se sont sentis bien seuls, chouchoutés par les Allemands, récemment lors de la Berlinale, sans le Maroc.
En effet, le réalisateur reproche de ne pas voir une affiche qui dit que le Maroc est présent à la biennale comme font les Ukrainiens ou les Italiens. Le Maroc ne se sent-il pas concerné par ses talents, ses ambassadeurs culturels ? «Il faut déterminer ce que l’on veut faire : est-ce qu’on veut faire un cinéma interne, local, commercial, dans ce cas-là, pourquoi il n’y a pas assez de salles? Veut-on un cinéma de rayonnement ? Moi, je considère qu’à partir du moment où mon film est à Cannes ou à Berlin, mon travail est accompli. Je ne comprends pas que le Liban, la Bretagne, alors que je n’y ai jamais tourné, s’intéressent à mon projet et veulent se voir associer à mon film. Le Maroc ne prend même pas la peine de mettre un flyer pour dire : le Maroc est à Berlin ! Et la remarque nous a été faite à Berlin», s’indigne Lasri.
Aller de l’avant…
Malgré cette petite déception, Lasri n’abandonne pas. Il vient de boucler un autre film. Souvent controversé, le réalisateur s’est vu critiquer pour sa fameuse série télévisée populaire «Kenza Fa Douar»: «Pour moi, ce film, c’est la continuité de «Kenza Fa Douar». C’est une autre recherche, un autre cinéma», s’amuse le réalisateur. «Si je n’ai pas de problèmes, c’est que je ne fais pas bien mon travail. C’est de bonne guerre». Mais le réalisateur avoue qu’il se sent soutenu par son public, par son pays en général. «Je n’ai pas d’ennemis. Mon ennemi, c’est le manque d’inspiration. Tu as un téléphone ? Va tourner. Pourquoi tu attends l’autorisation ? Un artiste ne demande jamais de permission. Ce qu’on pense, on peut le transformer en création. Dans le fond, que je passe de «Starve your dog» qui a coûté 100.000 DH à celui qui a coûté 100 fois plus, dans l’écriture ça ne change pas. Dans ma vision, je ne filme que des comédiens. Les basiques : caméra, comédien, ce que tu as à dire. Dans cette équation, je ne mets ni argent, ni commission, ni même pays». Seul le travail et le courage comptent pour le cinéaste de 39 ans qui souhaite voir une nouvelle génération de jeunes de 20 ans proposer leurs idées, essayer de nouvelles choses . «Créer doit être une fête. Les idées sont plus fortes que la mauvaise foi». Ainsi soit-il !