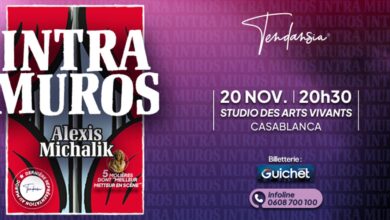Cinéma : Austin Butler “Pris au piège” d’un punk à chat

Le nouveau film de Darren Aronofsky surprend très agréablement. Avec un casting aussi incroyable que discret à l’écran, «Pris au piège — Caught stealing» propulse Austin Butler et Zoë Kravitz dans les bas-fonds new-yorkais de 1998. Une comédie noire en forme de thriller nostalgique de la ville de prédilection du cinéaste.
Darren Aronofsky est connu pour des films exigeants, de «Pi» (1998) à «Blackswan» (2010), en passant par «Requiem for a dream» (2000) et «Mother!» (2017). Ce nouveau long-métrage en forme de thriller rempli d’humour noir est, à côté de ses travaux précédents, une œuvre très grand public.
Punk à chat
Un ancien espoir du baseball, Hank Thompson (Austin Butler), plonge dans le milieu criminel du New York des années 1990. Privé d’une carrière prometteuse par un accident de voiture, il survit à New York comme barman. Il y est un «small town boy», un provincial un peu trop gentil, aux yeux de ses relations plus aguerries, comme sa petite amie Yvonne (Zoë Kravitz).
Les deux acteurs sont absolument parfaits. Butler en cliché de l’adolescent américain qui n’arrive pas à grandir convainc tellement qu’il surprend quand l’adulte se réveille, livrant une étonnante palette de jeu. Kravitz campe à la perfection la courageuse infirmière, bien décidée à goûter au meilleur de ce que la vie peut lui offrir, tant que cela reste en conformité avec ses valeurs d’altruisme et d’humanité.
Gentil, Hank accepte de rendre service à son voisin de palier, l’inénarrable Matt Smith transformé en Russ, un punk britannique portant haut sa crête iroquoise. Punk il est, mais il a un chat, pas un chien. Hank ne cesse de répéter qu’il préfère les chiens.
Cependant le chat, qui mord tout le monde sauf lui, le choisit lui-même comme gardien. La performance du chat de caractère est d’ailleurs remarquable. Russ parti, d’étranges personnages rôdent soudain sur le palier. Leurs airs patibulaires et leurs crânes rasés n’annoncent rien de bon, et, en effet, la violence va se déchaîner sans que Hank n’ait aucun moyen de comprendre pourquoi.
Aronofsky (cœur) New York
En 1998, les tours jumelles définissent toujours la skyline, les vidéos-clubs (tant aimés par le réalisateur) brillent encore de leurs néons et Rudy Giuliani est le maire de la ville. Hank Thompson doit le rappeler à ses clients, car un arrêté municipal leur interdisait alors de danser dans les bars. C’est aussi le New York dans lequel le réalisateur avait tourné son premier long-métrage, «Pi». La nostalgie passe donc par de brefs, et souvent drôles, éléments du décor soigneusement reconstitué, au graffiti près.
L’interminable course-poursuite qui se déroule sur ce fond urbain est poussée au pas de charge par des gangsters que Hank croit d’abord ukrainiens. «Non, russes. Ils sont plus violents et leur nourriture est moins bonne», doit lui expliquer la détective désabusée, jouée par l’excellente Regina King. Non moins inquiétant, un duo de malfaiteurs juifs en tenue haredim apparaît, menaçant, dans le paysage urbain.
Il faut un certain temps pour reconnaitre les acteurs Liev Schreiber et Vincent D’Onofrio sous leurs barbes. Taquin, Aronofsky conduira la caméra jusque chez leur maman, une veille de shabbat. Le roman à l’origine du scénario date de 2004, et la production a commencé en 2013. On ne peut donc prêter au film d’intention politique liée à l’actualité.
D’autant que ces premiers voyous sont vite rejoints pas un improbable porte-flingue nommé Colorado. Il est joué par Benito Martínez Ocasio, acteur plus connu sous son nom de rappeur, Bad Bunny, et pour son travail pour l’île de Porto Rico, dont il est originaire.
Toutefois, ces choix de New-Yorkais bigarrés reflètent bien les préoccupations de la cité à l’époque. S’ensuivent donc, à un rythme haletant et savamment dosé, une série d’imbroglios — et de cadavres — qui ne sont pas sans rappeler, de très loin, l’univers hitchcockien, où un innocent est embarqué dans un rapport de force qui le dépasse.
Asphalt jungle
Film d’amour des quartiers pauvres de la ville de New York, l’«asphalt jungle» cher aux années 1990 est tout à fait percutant, dans l’esprit bien compris de cette décennie cinématographique. L’hommage au «After Hours» (1985) de Martin Scorsese est assumé, mais on cherche en vain une référence directe à Jim Jarmusch (sauf peut-être avec la mention d’une ville de Paterson dans une adresse californienne ?).
Les frères Coen, en revanche, semblent avoir été les parrains tutélaires veillant au-dessus de l’objectif. Comme chez eux, le comique ne naît que de la logique implacable des situations et retournements, ainsi que du réalisme du jeu des acteurs. S’il n’est pas question de psychologie des profondeurs, le scénario de ce film d’action est superbement écrit — par Charlie Huston, l’auteur du roman éponyme — et sait toucher des points sensibles sans en avoir l’air. Les jeunes (et moins jeunes) gens estiment souvent que les femmes leur posent des questions inappropriées ou au mauvais moment. C’en est un cliché cinématographique.
Ainsi, Zoë Kravitz choisit de demander à Austin Butler de prouver qu’il sait prendre ses responsabilités afin que leur engagement puisse devenir sérieux, alors que la pression de la violence vient de devenir insupportable, à tous points de vue. Mais elle livre ce faisant la clé du personnage de Hank Thompson. Celui-ci mettra, on s’en doute, un certain temps à s’en apercevoir. Enfin, puisque toute cette histoire rocambolesque tourne autour d’un punk britannique à l’iroquoise flamboyante (il faut le voir dans sa voiture), inutile de préciser que la bande-son est particulièrement soignée.
Dans le genre punk. La majorité des morceaux est due au groupe The Idles. Une reprise très irrévérencieuse de «Police and Thieves» (un titre mythique de The Clash) est montée sur des images qui rendent une scène d’une grande tension surprenamment hilarante. Si un doute subsistait sur les intentions comiques, il n’est qu’à profiter du générique de fin, qui n’est pas sans rappeler ceux de la «Panthère rose» de Blake Edwards, félins obligeant, mais peut-être au psychédélisme plus «destroy».
Pour les gourmands, il faut savoir que le roman est le premier volet d’une trilogie. Mais tout bon film n’appelle pas forcément de séquelles. Savoir partir sur une comédie réussie fait aussi partie du grand art.
Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO