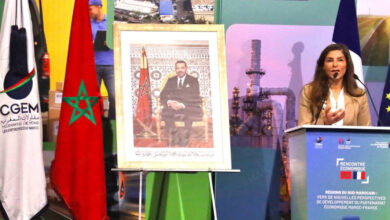Pacte pour les migrations. Les six promesses de Marrakech

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté à Marrakech. Décryptage du contenu et des enjeux de ce texte.
Le 11 décembre, Louise Arbour et Nasser Bourita, respectivement SG de la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour les migrations et président du même événement, quittent la salle de la plénière à 19h 30 et peuvent enfin souffler. La diplomate canadienne et son homologue marocain ont mené à bon port le texte du pacte pour son adoption par l’Assemblée générale (AG) de l’ONU, le 19 décembre prochain. L’AG comptera sur le soutien effectif de 163 États pour valider ce nouveau texte non contraignant. «Le pacte est une promesse», résumait le roi Mohammed VI dans son allocution lors de la séance d’ouverture du 10 décembre. Cette promesse se compose de 23 objectifs. Le document prévoit des moyens de mise en œuvre ainsi que des mécanismes de suivi et d’examen. À Marrakech, la parole a pris le dessus sur les engagements précis et chiffrés. Les États favorables à ce pacte seront attendus sur le terrain de l’action.
Promesse n°1
Sauvegarder la souveraineté
«Le pacte réaffirme le droit souverain des États à définir leurs politiques migratoires nationales […]. Compte tenu de la diversité des situations, […] les États peuvent, dans les limites de leur juridiction souveraine, opérer la distinction entre migrations régulières et irrégulières», indique le pacte dans le point C. «La souveraineté» a occupé les devants de la scène tout au long de cette conférence. Arbour n’a pas hésité à marteler ce principe dans chacune de ses déclarations pour rassurer les 17 États encore réticents à signer ce texte. Antonio Guterres, SG de l’ONU, a fait de même. Pourtant, le fossé entre les États qui font encore confiance au multilatéralisme et les autres Nations menées par les États-Unis se creuse.
Promesse n°2
Maximiser la sécurité
Sur les vingt-trois objectifs du pacte, dix sont en lien direct avec les questions de sécurité, de surveillance des frontières et de lutte contre la migration irrégulière. Khalid Zerouali, wali-directeur de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, affiche sa satisfaction à ce propos : «Si on part du postulat que la migration fait partie de l’activité humaine, soit on offre aux candidats des canaux sûrs de mobilité pour réaliser leurs projets migratoires, soit ce sont les criminels qui le feront. C’est pour cette raison que nous avons toujours estimé qu’une migration régulière et ordonnée est la meilleure manière de répondre à l’immigration irrégulière». Cette demande pour une migration régulière et ordonnée émane aussi des pays du Nord. Bon nombre de pays européens ont insisté pour davantage d’échanges d’informations autour des migrants, comme l’ont souligné les représentants des Pays-Bas et du Danemark, rappelant l’objectif n°3 du pacte : «Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration». L’appétence sécuritaire du pacte inquiète les associations de défense des migrants. Un groupement d’ONG nationales et internationales a tenu un sit-in le 10 décembre à Marrakech pour «dénoncer les aspects sécuritaires du pacte». Hassan Ammari, membre d’Alarm Phone, craint le pire avec ce nouveau texte : «C’est la porte ouverte aux centres de détention de migrants, au Nord comme au Sud».

Promesse n°3
Permettre aux migrants d’accéder à leurs droits
Certainement, c’est une des avancées majeures de ce texte. Contrairement aux réfugiés, les migrants n’étaient pas toujours reconnus par un texte onusien. Aujourd’hui, c’est chose faite. «Les réfugiés et les migrants jouissent des mêmes libertés fondamentales et droits de l’homme universels, qui doivent être respectés, protégés et exercés en toutes circonstances». Le pacte prévoit au moins quatre objectifs relatifs à l’accès aux différents droits. Younous Arbaoui, de la Plateforme nationale de protection des migrants, entend faire de ce texte un outil de plaidoyer: «Certes, le texte n’est pas contraignant, mais il comporte un engagement moral des États», insiste-t-il. Même son de cloche pour Monami Maulik, de la Coalition globale pour la migration: «malgré les limites de ce texte, nous sommes persuadés qu’il comporte des avancées qu’il faudrait saisir».
Promesse n°4
Établir des politiques locales
Face aux réticences des États, les équipes de l’ONU ont baissé leurs ambitions. Louise Arbour, femme-orchestre de cette dynamique, évoque des initiatives au lieu d’engagements. Dans le cas des pays du Sud, on n’hésite pas à faire preuve de volontarisme. C’est le cas du Maroc. «Le pacte conforte les choix du Maroc. Nous disposons déjà d’une politique migratoire nationale depuis 2013. Le pacte doit nous inspirer pour d’autres politiques», recommande Bourita. Pour l’heure, les déclarations des États ont été générales, ne dépassant pas les positions de principes. Lors du panel de haut niveau sur les partenariats et les initiatives innovantes tenu le 11 décembre, les représentants des États se sont limités à des déclarations politiques générales. Seule la mairesse de Madrid, Manuela Carmena Castrillo, a livré un engagement ferme et concret en soutien aux nouveaux migrants installés dans sa ville. «Nous sommes fiers d’être voisins du continent africain et de recevoir des jeunes africains», lance-t-elle lors de ce panel. Cette vision de Madrid est partagée par le pacte qui invite à la mobilisation de tous les pouvoirs publics. «Afin d’élaborer et d’appliquer des politiques et pratiques migratoires efficaces, il faut mobiliser l’ensemble des pouvoirs publics en vue de veiller à la cohérence horizontale et verticale des politiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’État».
Promesse n°5
Responsabiliser les médias
Jamais les médias n’ont été autant au cœur des polémiques que durant l’adoption du pacte, au point que le SG de l’ONU a consacré à ce thème une large partie de son discours inaugural. Le pacte consacre un objectif au rôle des médias: «Nous devons en outre mettre à la disposition de tous les citoyens des informations objectives, claires et fondées sur des données factuelles au sujet des avantages et des difficultés que présentent les migrations, en vue de démonter les discours trompeurs qui donnent une image négative des migrants». Parmi les organisations engagées dans ce sens, on peut citer l’Organisation internationale de la francophonie qui a affiché sa prédisposition à œuvrer pour améliorer le traitement médiatique de la migration.
Promesse n° 6
Établir des bilans
Comment évaluer le succès ou l’échec du pacte ? «Chaque objectif est associé à un engagement, suivi d’une série de mesures regroupant des moyens d’action et des pratiques optimales. Nous nous appuierons sur ces mesures pour atteindre les 23 objectifs et faire en sorte que les migrations soient sûres, ordonnées et régulières à toutes les étapes», s’engagent les États adoptant ce document. Louise Arbour invite d’ailleurs les États à procéder à cet examen : «Le pacte invite les États à réaliser des évaluations au niveau national et régional. Vu l’intérêt de la société civile, des médias et du secteur privé, il y a une forte volonté de mesurer la mise en œuvre de ce pacte». Le 19 décembre prochain, les États membres de l’ONU auront l’occasion d’adopter le texte officiellement lors de l’AG à New York. Le pacte résume les enjeux de cette nouvelle étape : «Il est crucial que nous ne nous laissions pas diviser et que nous restions unis face aux difficultés que posent les migrations internationales et aux occasions qu’elles offrent».
Dr Joanne Liu
Président de Médecins sans frontières
Les politiques migratoires actuelles déshumanisent et précarisent davantage le migrant qui essaie de passer d’un endroit à un autre. Sans facilitation de l’accueil des migrants ou du dépôt d’une demande d’asile, ces personnes sont poussées à emprunter des parcours périlleux.
Louise Arbour
SG de la conférence intergouvernementale pour la migration
Le pacte veut maximiser tous les bénéfices de la mobilité humaine. Il favorise la coopération internationale en matière de migration entre tous les acteurs compétents, sachant qu’aucun État ne peut gérer seul la question des migrations, et respecte la souveraineté des États et les obligations que leur impose le droit international.
Nasser Bourita
Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
Le pacte aura à relever trois défis. Le premier est celui de l’universalité en permettant de fédérer les États membres de l’ONU. Le deuxième touche à la mise en œuvre et il pourra être mesuré à l’aune de l’appropriation par les États du document. Le troisième est la nécessité de déconstruire les mythes et les stéréotypes pour pouvoir avoir une meilleure connaissance du phénomène.
Les migrations en chiffres
258 millions. C’est le nombre de migrants internationaux
80%. C’est le taux de la migration régulière dans le monde
596 milliards de dollars. C’est le montant des transferts des migrants à leurs pays d’origine
85%. C’est le taux des revenus générés par les migrants qui restent dans les pays de destination.
4 migrants africains sur 5 restent en Afrique
La migration africaine est d’abord intra-continentale