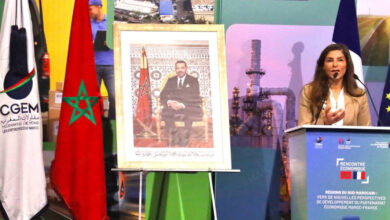Science : le Cercle psychanalytique décrypte “Les structures psychiques” de Vannier (VIDEO)

Le 22 mars, le Dr Alain Vannier a donné une conférence, à l’université Mundiapolis de Casablanca, intitulée «Les structures psychiques». Organisée par l’association Le Cercle psychanalytique, elle visait la formation des psychologues et psychanalystes.
Longtemps considérée comme une discipline ésotérique, la psychanalyse s’attache pourtant à décrypter les mécanismes profonds de l’esprit humain. Au Maroc, elle trouve progressivement sa place, portée par des initiatives académiques et associatives.
C’est dans ce cadre que Le Cercle psychanalytique a récemment organisé un séminaire réunissant chercheurs et praticiens autour des enjeux de la formation et de la transmission de la psychanalyse.
En introduction, Jalil Bennani, discutant de cet événement, a précisé : «L’association marocaine Le Cercle psychanalytique a été créée en 2009. Elle s’est donné pour objectif d’organiser des séminaires et d’aider à la recherche ainsi qu’à la formation des psychanalystes. Cette formation n’est pas facile, mais c’est quelque chose de très sérieux, qui prend du temps. Vous allez pouvoir découvrir ou approfondir cette discipline».
Le Cercle avait participé à la création d’un certificat de psychanalyse, inscrit à la faculté Cadi Ayad, de Marrakech. La formation théorique, en tant que champ du savoir, compte beaucoup. En lien avec le réseau de l’Espace analytique, à Paris et dans d’autres pays comme la Belgique, le Brésil ou le Liban, l’association marocaine se donne en effet pour but d’assurer la formation, la recherche et l’enseignement de la psychanalyse au Maroc.
Pour atteindre ces objectifs, elle se propose d’assurer une formation théorique incluant des séminaires théoriques, une ouverture à l’Université et des conférences dans des lieux publics. Elle propose de même une formation pratique reposant sur différentes modalités de transmission de la psychanalyse, l’impulsion d’une recherche sur de nouveaux moyens relatifs à cette transmission, un appui sur la clinique, l’analyse dite de contrôle…
Le Cercle psychanalytique veille enfin à renforcer la spécificité du discours analytique en lui réservant pleinement la place qui lui revient dans le champ culturel. Son président, le Dr Hachem Tyal, a participé au séminaire, ouvrant et clôturant les discussions.
Baudelaire avant Freud
Alain Vanier est «particulier» par son parcours, a expliqué Hachem Tyal, en le présentant à l’audience. Il est psychanalyste, ex-président d’Espace analytique, ancien psychiatre des hôpitaux et professeur émérite de l’Université Paris Cité. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages dont «Lacan» (éd. Les Belles Lettres), «Une introduction à la psychanalyse» (éd. Armand Colin, 2018), et «Épistémologie et méthodologie en psychanalyse et en psychiatrie» (éd. Érès, 2017).
Sa formation initiale portait sur les Lettres et la philosophie. Il a été professeur de collège avant de s’investir dans la médecine, la psychiatrie et l’analyse. À l’université de Paris, il a notamment dirigé le laboratoire «Centre de recherches psychanalyse, médecine et société». C’est donc avec un grand naturel que Vannier cite Charles Baudelaire : «Le monde ne marche que par le malentendu. C’est par le malentendu universel que tout le monde s’accorde. Car si, par malheur, on se comprenait, on ne pourrait jamais s’accorder.» Le poète écrit cela 30 ou 40 ans avant la découverte de la psychanalyse par Sigmund Freud.
Ce «malentendu universel», ou cette incommunicabilité des êtres qu’ont tant exploré la littérature et le cinéma des années 1950 à 1970, est donc le point de départ de la réflexion du conférencier. Point de départ puisque la condition humaine, selon lui, mais aussi point de départ historique, puisqu’au moment ou peu après la parution du livre «Mon Cœur mis à nu» (1887), les premières observations cliniques du Dr Charcot, auprès de qui le jeune Freud allait étudier, révolutionnaient l’approche médicale des souffrances psychiques.
Pour autant, remarque Vannier, aujourd’hui encore, rien des approches biologiques n’a véritablement bouleversé le champ de la clinique psychologique. Ainsi, les neurosciences, très utiles par ailleurs, n’ont rien apporté aux thérapeutiques de la psyché, souligne-t-il. Le fameux DSM non plus, puisque ce dictionnaire médical n’a «strictement aucune valeur clinique. D’ailleurs ses rédacteurs ont été étonnés de le voir utilisé dans la pratique clinique, alors que c’était un outil d’homogénéisation pour les études statistiques, ce qui n’avait strictement rien à voir», tient à préciser Alain Vannier.
Une histoire et du langage
Les descriptions de «ce que nous appelons des maladies mentales» se retrouvent jusque dans l’Antiquité. Les anciens Égyptiens décrivaient l’hystérie. Il y a une petite classification chez Hippocrate (la manie, la mélancolie, etc.). Mais les soins proposés pouvaient être très fantaisistes, notamment pour l’hystérie.
Puis, il y a «une grande zone d’ombre en Occident», note le conférencier, où une sorte de démonologie a pris le dessus. Le psychiatre renvoie l’audience au livre désormais classique «L’Histoire de la folie à l’âge classique», de Michel Foucault, pour voir toutes les variations du traitement des «fous» en Europe. Vannier tient à signaler qu’au même moment historique, mais dans le monde arabe, des gens comme Rhazès (Al-Razi) ou Avicenne (Ibn Sina) ont fait un travail d’observation et de classification de la «folie» assez intéressant et rationnel, qui s’est conservé jusqu’à il y a peu. «On pouvait voir des patients traités, parfois bien accueillis autour des lieux saints», précise le psychanalyste.
L’apport de Freud, estime-t-il, aura d’abord été de placer la question du sexe au centre du diagnostic. Charcot, son maître en clinique, en parlait en privé, à propos de ses malades, mais n’avait pas eu le courage d’aller à l’encontre des préjugés de son temps.
Après Freud, obsédé par l’idée de respecter les canons de la science, pour résumer grossièrement un propos beaucoup plus nuancé, va venir Jacques Lacan, dont la première confrontation ne sera pas avec l’hystérie, mais avec la psychose. S’il garde les trois grandes catégories de névroses, psychoses et perversions, il va réinterroger les structures définies par Freud, et, par exemple, réduire singulièrement le rôle attribué au fameux complexe d’Œdipe par le Viennois. La théorie du langage — comme celle des langages maternel et paternel — va prendre une plus grande part.
Vannier atteint alors un niveau de langage, justement, qui ne saurait se réduire à un modeste article de presse. Pour en savoir plus, il faudra sans doute suivre les prochaines conférences organisées par Le Cercle psychanalytique, ou se renseigner sur quelques bons ouvrages à lire.
Murtada Calamy / Les Inspirations ÉCO