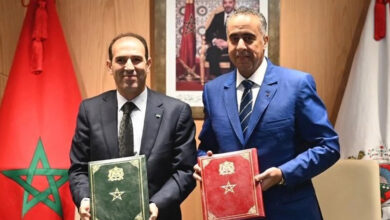Risques climatiques à Tanger-Tétouan-Al Hoceima : quatre leviers stratégiques pour renforcer la préparation financière

Face à une élévation du niveau de la mer atteignant 5,2 mm/an, le rapport du Global Environment Facility (GEF) MedProgramme propose un cadre financier et réglementaire pour protéger le littoral nord-marocain. Comment la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima peut-elle éviter la crise climatique ? Décryptage des solutions.
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), épicentre économique et écologique du Nord, incarne les paradoxes d’un littoral méditerranéen à la fois dynamique et vulnérable. Entre montée des eaux, érosion côtière et pressions socio-économiques, les enjeux d’adaptation climatique y exigent une refonte des mécanismes financiers. Le rapport du Global Environment Facility (GEF), réalisé dans le cadre du projet MedProgramme, identifie quatre recommandations clés pour combler les lacunes structurelles. Analyse.
Créer des Fonds climatiques spécialisés : une nécessité pour canaliser l’investissement
Le Maroc, bien que pionnier en matière d’initiatives vertes avec le Fonds Vert pour l’Investissement (MGIF) et les obligations vertes, accuse un retard critique dans le financement dédié à l’adaptation côtière.
Le rapport souligne que «les structures financières existantes ne soutiennent pas suffisamment les projets d’adaptation à grande échelle», pourtant vitaux pour protéger les infrastructures et écosystèmes de la région TTA face à une élévation du niveau de la mer atteignant 5,2 mm par an.
Les fonds climatiques spécialisés, ciblant explicitement les zones côtières, permettraient de prioriser des projets locaux tels que la restauration des zones humides ou la construction de digues écologiques, en alignement avec les objectifs du Plan National d’Adaptation (PNA).
L’enjeu réside dans l’élimination des silos organisationnels et fonctionnels des financements existants – notamment ceux du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) ou de la Banque Mondiale – afin de les orienter vers des actions concrètes inscrites dans le Schéma régional du littoral de la région TTA.
Une telle approche faciliterait également la mobilisation de fonds internationaux, aujourd’hui majoritairement captés par des projets d’atténuation. Selon des projections analogues à celles du rapport, l’absence de ces mécanismes dédiés pourrait coûter jusqu’à 2,5% du PIB régional d’ici 2030, en raison de dommages accrus aux infrastructures, de pertes agricoles et de perturbations touristiques.
Adapter les produits financiers aux risques climatiques
Les institutions financières marocaines, bien qu’engagées dans des dynamiques de finance durable, peinent à concevoir des produits intégrant pleinement les risques climatiques, en particulier dans le secteur côtier. Ce déficit s’explique par un «manque de capacité et d’expertise» pour structurer des instruments innovants, tels que les obligations bleues ou les prêts indexés sur des critères de résilience climatique.
Pour combler cette lacune, les banques doivent internaliser les risques physiques (inondations, érosion) et transitionnels (striction des régulations carbone) dans leurs modèles d’évaluation. Par exemple, conditionner l’octroi de prêts à des hôtels côtiers à l’adoption de solutions fondées sur la nature (SFN), comme la revégétalisation des dunes, réduirait leur vulnérabilité tout en sécurisant les investissements.
Les assureurs, acteurs clés, doivent quant à eux affiner leur analyse de l’exposition des secteurs sensibles (tourisme, pêche) et développer des produits de couverture adaptés, tels que des polices paramétriques déclenchées par des seuils climatiques précis.
Cependant, ces avancées se heurtent à deux obstacles majeurs : la faiblesse des données climatiques locales, essentielle pour modéliser les risques, et l’absence de méthodologies standardisées d’évaluation, freinant la comparabilité et la confiance des investisseurs. Sans résolution de ces défis, la «bancabilité» des projets d’adaptation restera un mirage, limitant l’accès aux capitaux privés pourtant indispensables à la résilience de la région TTA.
Renforcer les cadres réglementaires : catalyseur des partenariats public-privé (PPP)
Le potentiel des partenariats public-privé (PPP) dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima reste largement inexploité, en partie à cause de «barrières réglementaires et [d’un] manque d’incitations», comme le souligne le rapport.
Pour mobiliser les investisseurs privés dans des projets critiques – tels que la modernisation des ports ou le développement d’une agriculture résiliente –, un cadre juridique clair et sécurisant est indispensable. Celui-ci doit inclure des mécanismes de garantie contre les risques politiques, des incitations fiscales ciblées (exonérations temporaires, crédits d’impôt), et une définition précise des responsabilités en cas de sinistres climatiques.
Le rapport insiste sur la nécessité de «politiques incitatives alignées sur les objectifs du PNA», notamment via une révision de la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) pour y intégrer des clauses spécifiques aux zones côtières.
Le projet pilote SCCF dans la région TTA illustre cette dynamique : en associant gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et solutions fondées sur la nature (SFN) dans des PPP, il démontre que l’efficacité de ces partenariats dépend d’un encadrement réglementaire robuste, notamment sur le partage des risques.
Par exemple, un projet de restauration de mangroves financé via un PPP nécessiterait des accords clairs sur la répartition des coûts d’entretien entre acteurs publics et privés, ainsi que des mécanismes de révision contractuelle en cas d’événements climatiques extrêmes. Sans ces garde-fous, les investisseurs privés resteront réticents à s’engager dans des projets perçus comme trop risqués.
Construire des capacités institutionnelles : l’impératif de la donnée et de la formation
Le manque criant de compétences en gestion des risques climatiques au sein des institutions publiques et privées de la région TTA constitue un frein majeur à l’efficacité des politiques d’adaptation. Pour y remédier, le rapport préconise un double levier : le renforcement des systèmes de collecte de données climatiques locales et la mise en place de formations ciblées. La méthode du Plan Bleu, testée dans la région TTA via des ateliers participatifs, montre comment impliquer décideurs, scientifiques et société civile dans l’élaboration de scénarios climatiques territorialisés.
Ces ateliers permettent aux acteurs locaux de maîtriser des outils d’analyse tels que le Coastal Risk Index-Local Scale, essentiel pour prioriser les interventions. Parallèlement, les banques doivent développer une expertise fine sur la manière dont les risques physiques (hausse du niveau de la mer) et transitionnels (transition bas-carbone) affectent leurs clients – une tâche complexe nécessitant une collaboration étroite avec des climatologues et des urbanistes. Par exemple, une institution financière pourrait former ses équipes à l’utilisation de modèles prédictifs d’érosion côtière pour évaluer la vulnérabilité d’un projet hôtelier.
En l’absence de telles capacités, même les fonds climatiques les mieux dotés risquent d’être gaspillés dans des projets mal conçus, exacerbant les inégalités spatiales (zones urbaines vs rurales) ou sectorielles (tourisme vs pêche). L’enjeu est donc de transformer les institutions en acteurs éclairés, capables de traduire des données climatiques en décisions d’investissement résilientes.
Passer d’une logique de projets pilotes à une massification des financements
Les quatre recommandations du rapport forment un écosystème interdépendant : des fonds spécialisés sans produits adaptés resteraient inutilisés; des régulations solides sans capacités institutionnelles généreraient des blocages. Pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, laboratoire d’une Méditerranée en transition, l’enjeu est de passer d’une logique de projets pilotes à une massification des financements.
Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO