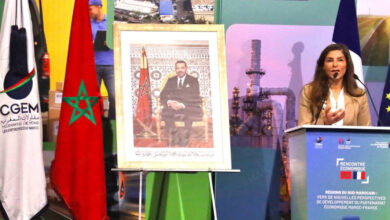Retraites. Les seniors menacés par une plus grande précarité

La baisse de la fécondité et le vieillissement de la population risquent de précariser encore plus les retraités, dont les pensions et les couvertures seront menacées par le déséquilibre engendré.
Si la majorité des politiques publiques visent désormais les jeunes actifs, les retraités continuent d’être le parent pauvre de l’action gouvernementale. Un constat amer qui, surtout, est en complète inadéquation avec l’évolution démographique du royaume. L’évolution de la population marocaine s’est accélérée au cours de la première phase de la transition démographique grâce à la baisse de la mortalité, particulièrement aux jeunes âges. L’amélioration des chances de survie aux jeunes âges a été le principal facteur de gain en espérance de vie à la naissance. De moins de 50 ans au début des années soixante, le Marocain peut espérer vivre, en moyenne, un peu plus de 75 ans dans les conditions de mortalité actuelle. Néanmoins, l’on peut remarquer une baisse tendancielle du rythme d’accroissement de la population qui s’explique principalement par le recul de la fécondité.
Après avoir culminé à plus de 7 enfants par femme au cours des années 1960-1970, le nombre moyen d’enfants par femme a chuté à un peu moins de 2,6 en 2018. En effet, au cours des années 1960-1970, la fécondité était très élevée avec 6,5 enfants par femme malgré les programmes de planning familial mis en oeuvre au milieu des années 60. L’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus passerait, entre 1960 et 2030, de près d’un million à environ 5,8 millions, soit une multiplication par près de 6. Le rythme de l’évolution de l’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus connaîtrait une croissance accélérée, notamment à partir de 2010. Avec une telle ampleur, le vieillissement serait à l’origine de profondes transformations économiques et sociales qui doivent être prises en considération dès à présent, d’autant plus que ces transformations risquent de menacer la solidarité intergénérationnelle qui constituait un rempart atténuant la précarité chez les personnes âgées. Ce phénomène multidimensionnel doit donc bénéficier d’une attention accrue, d’autant plus que deux éléments suffisent à mettre en évidence la fragilité de cette catégorie d’âge. Le premier est le risque qui menace la solidarité familiale. Bien que les différentes enquêtes du HCP montrent sans équivoque que la famille, y compris le ménage, demeure l’institution de référence pour le soutien aux personnes âgées, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas immuable. De moins en moins étendue, plus mobile et plus libérée des pesanteurs sociétales traditionnelles et surtout confrontée à un nouveau mode de vie qui est différent du mode traditionnel (d’antan), la famille risque de se trouver de moins en moins disposée ou préparée à prendre en charge convenablement des personnes âgées qui auront tendance à vivre plus longtemps. Le deuxième est la faiblesse des filets du système de sécurité sociale, seule 26,5% de la population âgée ayant déjà travaillé avant l’âge de 60 ans bénéficie d’une pension de retraite. Les bienfaits de la solidarité familiale ne peuvent donc pas se substituer à l’action publique. Les dernières données recoupées de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et ceux du HCP montrent que les maladies dont souffrent de manière chronique les personnes âgées sont, par ordre décroissant, les affections articulaires (33,3%), les maladies oculaires (14,6%), les maladies cardio-vasculaires (9,6%), le diabète (7,8%), les pathologies neurologiques et psychiatriques (6,8%) et les maladies respiratoires (6,0%). Cette distribution n’est pas uniforme et varie selon le sexe.

Ainsi, les femmes semblent souffrir plus que les hommes de certaines maladies: 40,7% d’entre elles ont déclaré avoir des problèmes articulaires, contre 25,2% chez les hommes. S’agissant des maladies cardio-vasculaires, ces proportions sont, respectivement, de 11,2% et de 8,0%; pour le diabète, elles sont de 8,9% et 6,5%. La fréquence élevée de ces affections chez les femmes pourrait s’expliquer par leur longévité comme en témoigne l’espérance de vie à la naissance, estimée, respectivement, à 73 et 70,6 ans en 2004. Par milieu de résidence, les donnéesmontrent peu de différence en matière de santé, à l’exception des maladies cardio- vasculaires (12,5% des citadins contre 6,5% des ruraux) et du diabète (11,1% contre 4,1%) qui apparaissent comme des pathologies touchant plus les citadins, probablement en raison des différences de modes de vie.
Pour cerner le degré d’incapacité physique sous toutes ses formes, un indicateur calculé sur la base des questions relatives à la possibilité d’effectuer certaines tâches quotidiennes a permis de répartir les personnes âgées en trois groupes. Les personnes sans incapacités, capables d’exécuter elles-mêmes toutes les tâches quotidiennes, représentent un peu plus des deux tiers, soit 69,3%. Celles souffrant d’une incapacité modérée, composées essentiellement de celles ayant besoin d’une aide pour l’accomplissement de certaines tâches seulement, représentent 26,8%. Enfin, les personnes frappées d’une incapacité sévère, constituées essentiellement de celles qui ont besoin d’une assistance pour effectuer toutes les tâches de la vie quotidienne, représentent 3,9%. Les femmes sont plus touchées par une incapacité physique que les hommes avec 4,8% contre 2,9%. Des différences apparaissent également selon les milieux de résidence. La complexité du cadre de vie urbain rend les personnes âgées encore plus vulnérables. Monter les escaliers, traverser la route n’est pas toujours facile pour une personne âgée ayant une lente démarche ou une vue altérée. C’est pourquoi les citadins sont plus atteints d’incapacité sévère que les ruraux (4,3% contre 3,5%). La forte vulnérabilité des personnes âgées aux différentes maladies, d’une part, et la détérioration de leur santé, d’autre part, les obligent à recourir fréquemment au système de santé.
Cependant, les deux tiers (66,6%) seulement des personnes âgées ayant été malades ont eu recours aux soins de santé au moins une fois pendant les six derniers mois précédant l’enquête (les citadins (73,3%) plus que les ruraux (58,7%), et les femmes (68,4%) plus que les hommes (64,5%)). Parmi ceux qui l’ont fait, 2,6% ont dû être hospitalisés en raison de la gravité de leur maladie.
FINACTU se chargera de la réforme systémique
À l’issue d’un appel d’offres international, le gouvernement a choisi FINACTU pour l’accompagner dans une nouvelle étape du processus de réforme. Le mandat confié par le ministère de l’Économie et des finances à FINACTU consiste à proposer un état cible du système de retraite, autour de deux pôles: l’un dédié au secteur public et l’autre au secteur privé, avec à terme la convergence des deux. Dans ses recommandations ayant suivi l’évaluation du système de retraite, la Cour des comptes insiste notamment sur la nécessité d’engager une réforme profonde avec comme objectif stratégique la création d’un pôle public, de manière à asseoir une convergence vers un régime public viable et pérenne, ainsi que l’unification des règles de liquidation des pensions dans l’ensemble du secteur public. Les magistrats financiers proposent également de s’orienter vers une tarification des prestations tenant compte de l’évolution démographique, sociale et économique que connaît le pays et d’opter pour un taux de remplacement raisonnable avec un traitement approprié au profit des populations à faible revenu.