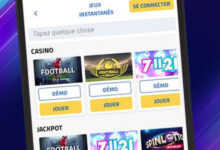Marchés publics : extension des contrats de droit commun aux secteurs stratégiques

L’arrêté n° 363/25 élargit la liste des prestations éligibles aux contrats de droit commun, incluant désormais le cannabis. Détails sur les mécanismes de transparence et les risques pour les PME.
Le cadre juridique des marchés publics marocains connaît une évolution notable avec l’extension des prestations éligibles aux contrats de droit commun. Cette réforme, matérialisée par l’arrêté n° 363/25 de février 2025, s’inscrit dans une dynamique d’adaptation aux réalités économiques et sectorielles.
Les contrats de droit commun : une exception encadrée
Le décret n° 2-22-431 régit les marchés publics en imposant des principes stricts : transparence, égalité de traitement et concurrence. Toutefois, il prévoit une exception pour les contrats de droit commun, réservés à des prestations «déjà définies quant à leurs conditions d’exécution et de prix», où le maître d’ouvrage n’a «pas intérêt à modifier ces paramètres» (Article 4).
Nouveauté 2025 : la liste limitative de l’annexe 1 du décret a intégré en mars 2025 les prestations liées au cannabis, suite à l’arrêté ministériel n° 363/25. Cette extension s’ajoute à des secteurs préexistants comme la location d’espaces publicitaires, l’achat de noms de domaine ou la location d’immeubles.
Auparavant, l’accès aux contrats de droit commun était plus restreint. Désormais, l’État en élargit progressivement le périmètre pour inclure des secteurs innovants ou stratégiques, tout en maintenant un équilibre via des contrôles ex post.
Motivations économiques et sectorielles
Selon Maître Deryany Reda, avocat d’affaires, cette réforme répond à une logique d’efficacité économique : «Le développement de l’économie et la mouvance de la politique économique tendent à favoriser certains secteurs d’activité. Le cannabis en est un exemple récent, mais cela pourrait concerner demain le numérique ou les énergies vertes».
Objectifs clés : simplifier les procédures pour des prestations où la qualité technique prime sur le prix (ex : location d’infrastructures) ; attirer des investisseurs dans des niches émergentes (cannabis thérapeutique), en réduisant les lourdeurs administratives ; s’adapter aux spécificités sectorielles, où une concurrence classique serait contre-productive.
PME vs grands groupes : un équilibre fragile
La flexibilisation pourrait avantager les acteurs disposant de réseaux ou de capacités financières, au détriment des PME. Toutefois, le droit marocain prévoit des mécanismes atténuateurs. Les établissements publics doivent publier annuellement le nombre et le montant global des contrats conclus, par nature de prestation (sans révéler les attributaires).
«Cette solution demeure faible, car l’identité des attributaires n’est pas dévoilée», souligne notre expert.
L’Observatoire de la commande publique (OMCP), bien qu’utile, devra prouver son efficacité pour éviter une opacité persistante.
Nouvelles obligations
Les entreprises candidates doivent s’assurer que leur prestation figure bien dans l’annexe 1 du décret. La Commission nationale de la commande publique (CNCP) joue un rôle pivot en clarifiant les textes, réduisant ainsi les litiges.
Contrairement à une idée reçue, l’arbitrage international n’est pas une conséquence directe de ces contrats. Le droit marocain autorise déjà les établissements publics à y recourir, quel que soit le mode de passation (loi 95-17).
Agilité vs transparence, un défi permanent
La réforme des marchés publics marocains reflète une volonté d’équilibrer efficacité économique et intégrité juridique. Si l’élargissement des contrats de droit commun ouvre des opportunités sectorielles, il exige un renforcement parallèle des mécanismes de transparence.
L’OMCP et la CNCP seront des acteurs clés pour concrétiser cette ambition, dans un contexte où innovation légale doit rimer avec redevabilité publique.
Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO