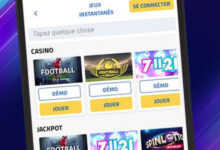Céréales : le projet de stock stratégique prend enfin forme

La Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) a détaillé le futur stock stratégique de céréales. Mode d’emploi de ce dispositif clé dont les contours et les modalités ont été exposés lors d’une table ronde, initiée jeudi dernier, sur les enjeux de la filière céréales et légumineuses, en marge du SIAM.
Face à une production céréalière (notamment pour le blé tendre, le blé dur et l’orge) structurellement affaiblie par sept années de sécheresse, la production nationale est largement conditionnée par la régularité des précipitations, notamment en volume et en répartition aussi bien temporelle que spatiale. Une donne qui accentue la dépendance du Maroc aux importations, avec la hausse de la facture ces dernières années.
En chiffres, la céréaliculture, filière stratégique, est pratiquée en quasi-totalité en culture pluviale avec une superficie atteignant 4,5 millions d’ha en année pluvieuse (soit la moitié de la superficie agricole utile du pays) dont seulement 300.000 ha environ en irrigué.
Le Royaume a fait le pari de la constitution de stocks stratégiques pour faire face aux contraintes d’approvisionnement en vue d’éviter les perturbations des marchés mondiaux touchés depuis 2007-2008.
En effet, ces derniers ont connu plusieurs chocs majeurs qui se sont traduits par de fortes hausses des cours. Le projet du stock stratégique de céréales, dont la réflexion a été menée avec un cabinet spécialisé, a été initié par la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL). Ses contours et ses modalités ont été exposés lors d’une table ronde sur les enjeux de la filière céréales et légumineuses, en marge du SIAM.
Une autonomie prévue de stockage de quatre à six mois
En ces temps de crises multiformes il est de plus en plus «nécessaire de constituer des stocks stratégiques pour ne plus être vulnérable à l’approvisionnement d’une matière aussi importante que le blé», a rappelé Omar Yacoubi, président de la FNCL.
«Nous avons réfléchi à ce processus portant sur ce stock qui doit être un débouché très important pour la récolte nationale et un outil à la disposition des autorités publiques pour pouvoir valoriser la récolte nationale», explique-t-il.
D’une autonomie prévue de quatre à six mois, le stock en question évoluera en fonction des besoins de l’État qui n’assumerait que le coût de stockage. Toutefois, les capacités de stockage, qui demeurent insuffisantes, devront être développées en construisant davantage de silos de stockage. Selon la FNCL, le processus recommandé porte sur des achats ordonnés par les pouvoirs publics. Le financement sera assumé par les opérateurs (CMA, SMA) alors que le stockage sera assuré sur la base d’indemnisations et du contrat-programme de la filière.
Des appels d’offres encadrés par l’État
Selon le modèle proposé, le mécanisme favorisera une collecte de blé local large et rapide, à des prix valorisés alors que la cible serait une autonomie de quatre à six mois. Il s’agit d’une fourchette qui pourrait évoluer en fonction des besoins de l’État avec l’optimisation de ce modèle. Quant au coût, il sera totalement maîtrisé par l’État, selon la FNCL. «Le stock stratégique doit préserver la libéralisation des importations sans pour autant qu’il perturbe les transactions sur le marché local, avec un prix cible de l’État».
Aujourd’hui, bien qu’il existe une prime de stockage, cette incitation doit évoluer, selon l’interprofession, et ce, en prenant en considération le coût de stockage et la réalité des coûts subis par le marché. Afin d’éviter le risque de prix à la sortie, la FNCL propose de passer par des appels d’offres encadrés par l’État pour éviter les fluctuations entre les prix d’entrée et de sortie. Outre le risque de qualité et sa gestion tout au long de la période du stockage, les paramètres à prendre en compte dans ce mécanisme sont liés à la mobilisation du blé tendre disponible sur le sol national sous forme de stock stratégique qui sera réparti en fonction des zones de consommation.
Par ailleurs, Bilal Hajjouji, directeur de l’ONICL, a traité la question de l’approvisionnement du marché national des céréales et des mécanismes mis en place par l’office pour gérer les périodes de tension.
Selon lui, «la filière céréalière revêt une importance capitale à plusieurs titres. La production nationale est marquée par une forte fluctuation, avec une forte dépendance vis à vis des aléas climatiques et une faible intégration dans le tissu industriel. D’où le recours quasi systématique aux importations pour couvrir les besoins du pays. De même, la chaîne de valeur de la filière montre une forte concentration de la logistique céréalière en termes de transit, stockage et transformation dans l’axe Casablanca-Fès. Ceci constitue un risque d’approvisionnement à ne pas négliger, surtout en situation de crise.
«Prenant en considération les contraintes internes et externes, l’ONICL arrête au titre de chaque année un régime de commercialisation relatif au blé tendre qui a pour principaux objectifs la collecte du maximum de la production nationale en vue de son intégration dans le tissu industriel, et ce, en garantissant bien évidemment un prix rémunérateur au producteur».
Dans le détail, la gestion par l’ONICL de l’approvisionnement du pays en céréales se base sur plusieurs éléments. Il s’agit d’une part de l’écoulement de la plus grande quantité possible du stock pour approvisionner les minoteries pour la production des farines subventionnées, avec la mise en place de droits d’importation convenables à la protection de la production nationale durant la période de forte collecte. Il y a, d’autre part, l’adoption d’un prix référentiel pour un blé tendre de qualité standard à la livraison aux minoteries et la mobilisation des primes de magasinage : 2,5 dhs/ql bimensuellement durant la période primable de la collecte et la prime forfaitaire à caractère variable.
Trois conventions signées
Par ailleurs, trois conventions ont été signées à l’issue de cette rencontre. La première est une convention de partenariat avec la FNCL pour renforcer les capacités mutuelles en termes d’analyse et d’études à caractère économique qui intéressent le secteur de la minoterie industrielle.
Elle intègre également les amendements techniques concernant les actions qui vont être menées. Quant à la seconde convention-cadre de partenariat entre l’ONICL et la FNM, elle porte sur le cahier des charges pour le stockage des céréales. Pour sa part, la troisième convention est un avenant technique au protocole de coopération tripartite entre l’ONICL, Intercéréales France et France AgriMer.
Cet avenant technique arrête les actions menées en 2025 pour le renforcement des compétences techniques économiques des deux parties dans le secteur des céréales, ainsi que des capacités de management de laboratoire de l’ONICL.
.
Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO