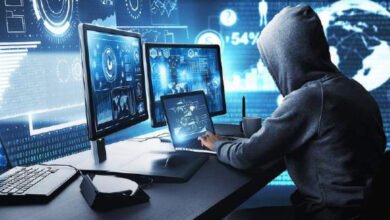Changement climatique. Les sols de la planète sont épuisés !

Selon les experts du GIEC, les sols se réchauffent deux fois plus vite que le globe. Par ailleurs, plus ils seront dégradés, plus leurs productivité et capacité à stocker du carbone seront affaiblies. Éclairages.
Après son étude sur le réchauffement climatique, qui a suscité, l’année dernière à la COP 24 à Katowice (Pologne), le besoin de rebattre les cartes pour pouvoir atteindre les objectifs de l’accord de Paris, le Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution climatique (GIEC) vient de publier les résultats d’une seconde étude portant cette fois-ci sur l’état des sols de la planète. Réalisée par une soixantaine de scientifiques, celle-ci a fait l’objet d’une présentation synthétique de 65 pages pour validation par les délégations des 195 États membres du groupement, au début du mois d’août à Genève. Qu’est-ce qu’il faut en retenir? Des révélations inquiétantes… mais aussi, heureusement, de l’espoir parce qu’il y a encore un angle de tir dont l’humanité peut actuellement se saisir pour changer la donne.
Un quart des sols en dégradation
L’un des premiers constats frappants de cette étude porte sur la proportion de terres touchées par l’homme. Selon l’évaluation du GIEC, l’être humain exploite déjà trois quarts des sols émergés et non englacés. Sur ce total, le quart est déjà en état de dégradation, c’est-à-dire qu’il subit une baisse drastique de productivité ou est déjà affecté par l’érosion. «Depuis le début des années soixante, l’usage des fertilisants a été multiplié par neuf, la quantité de bois utilisé de 50% tandis que l’usage de l’eau a doublé», expliquent les experts du GIEC qui ajoutent que «si la montée du niveau de la mer persiste, cela pourrait faire disparaître plusieurs îles (États insulaires) ce qui entraînerait ainsi la perte sèche de plusieurs terres». On n’en est pas encore là! Ceci étant, il faut quand même noter qu’il ne reste plus qu’un quart des terres de la planète non encore touché par l’homme et sur lequel il va falloir compter pour subvenir aux besoins de l’humanité dont la population va croissant. Le rapport du GIEC montre aussi que les terres se réchauffent deux fois plus vite que le globe. Les experts sont parvenus à cette conclusion en comparant la période 1850-1900 à celle de 2006-2015. C’est ainsi que, selon eux, la planète s’est réchauffée en moyenne de 0,87°C sur cette dernière période. Pire, en ajoutant le pic enregistré au mois de juillet de l’année en cours qui a été 1,2°C plus chaud que la moyenne historique, on aurait même dépassé +1°C. Du coup, les continents ont vu leur température de surface croître de 1,53°C en moyenne. Ce qui veut dire que les 1,5°C stipulés dans l’accord de Paris sont donc déjà dépassés dans ce que ressentent les humains et les écosystèmes terrestres.
Les villes les plus affectées
Dans cette situation, les villes sont les plus touchées, déclarent les experts. «Le réchauffement mondial et l’urbanisation peuvent exacerber l’augmentation des températures dans les villes et alentour, par l’effet des îlots de chaleur, notamment durant les canicules, précise le rapport. Les températures nocturnes sont plus affectées par cet effet que celles du jour». L’agrandissement continu des villes peut aussi renforcer les pluies extrêmes localement ou dans le sens des vents, ajoute l’étude. Pourtant, les terres rendent actuellement un grand service à l’humanité en pompant environ 29% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce phénomène, les forêts jouent un rôle essentiel. Et donc, d’après le rapport, la reforestation et la gestion durable des forêts seraient des solutions aux multiples bénéfices pour toute la planète Terre. «Le reboisement permet d’absorber plus de dioxyde de carbone, restaure les sols, favorise le développement de la biodiversité, réduit localement les températures grâce au phénomène d’évapotranspiration et diminue l’amplitude des événements extrêmes», énumère le rapport.
L’agriculture: bourreau et victime
S’arrêtant longuement sur l’agriculture, le rapport l’a décrite comme étant à la fois l’une des principales causes du dérèglement climatique et l’une des victimes qui en subit les plus dures conséquences. Exemple: d’ici 2030, une hausse de 20% de la production de riz sera nécessaire pour nourrir la demande croissante en Chine, poussée par l’accroissement de la population et l’amélioration du niveau de vie. Or, chaque degré de réchauffement réduit les rendements de blé de 6%, de riz de 3,2%, de maïs de 7,4% et de soja de 3,1%. Or, ces cultures fournissent actuellement deux tiers des apports en calories de l’humanité et les revenus de millions d’individus. Ce n’est pas tout! L’augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère provoque aussi une baisse de la concentration en zinc et en fer des céréales et des légumes. Les carences en oligo-éléments sont déjà un problème sanitaire majeur, affectant la vie de près de 2 milliards d’êtres humains. Près de 63 millions en meurent chaque année. Alors, face à cela, que préconise le GIEC? Les experts préconisent un changement d’alimentation et de modèle agricole, tout en se gardant de soutenir ouvertement un régime alimentaire spécifique.